Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
Un mot, deux mondes
Norbert Bolz, « Deutschland erwache » et les deux poids, deux mesures de l’État
Il reprenait, ironiquement, le titre que la taz avait déjà utilisé en 1997 : « Deutschland, erwache ? ».
L’un est subventionné, l’autre perquisitionné.
L’affaire en dit plus sur la manière dont notre époque traite le langage, l’ironie et l’appartenance politique que sur les articles de loi qui la fondent.
Ça commence par un tweet, seize mots à peine. « Bonne traduction de “woke” : Deutschland erwache ! »
La phrase est de Norbert Bolz, professeur émérite en sciences des médias, non pas un agitateur, mais un observateur ironique.
Il réagissait ainsi à un titre de la taz, qui – en 1997, puis à nouveau plus tard – avait publié cette même formule : « Deutschland, erwache ? ».
Un commentaire ironique sur la satisfaction politique de la République, lu à l’époque, sans contestation, comme une satire du centre gauche.
Vingt-huit ans plus tard, cette même expression devient le motif d’une procédure pour « utilisation de symboles d’organisations anticonstitutionnelles ».
Le 23 octobre 2025, le parquet de Berlin perquisitionne son domicile, saisit ses appareils et invoque l’article 86a du code pénal allemand.
Ce qui se joue ici n’est pas un débat de mots, mais un glissement du système juridique lui-même.
L’expression « Deutschland erwache ! » vient à l’origine du répertoire de la SA.
Son emploi n’est pourtant pas interdit en soi, seulement lorsqu’il exprime une adhésion ou une identification.
Bolz l’utilisait comme miroir, non comme drapeau.
La distinction est si évidente qu’elle devrait aller de soi en droit allemand.
Elle constitue le cœur de ce qu’on appelle « l’interprétation contextuelle » – cette ligne minimale de protection entre république libre et république moralisatrice.
Certes, la mise en balance entre liberté artistique et protection contre les symboles totalitaires est complexe ;
mais ignorer le contexte, c’est criminaliser la citation.
Renoncer à cette ligne, c’est transformer le droit pénal en instrument d’examen des positions politiques.
Le cas Bolz n’est pas isolé.
Il révèle un schéma : les mêmes mots peuvent être perçus, selon le milieu, comme provocation artistique ou comme motif de soupçon.
Ainsi, tandis qu’un professeur émérite est poursuivi pour une ironie, ce même État fédéral subventionne un projet musical portant exactement le même titre : « Deutschland erwache ! », financé en 2025 sous la responsabilité de la ministre de la Culture Claudia Roth.
Selon la justification officielle, il s’agit d’une œuvre d’art digne de soutien, participant au débat culturel sur l’identité.
Les mêmes mots, deux lectures opposées.
L’État, ici, est à la fois plaignant et mécène.
Il punit ce qu’il subventionne, et subventionne ce qu’il punit.
Le problème ne tient pas à une morale double, mais à la structure qui la rend possible.
En Allemagne, ce n’est plus l’acte qui décide, mais la position politique.
La culpabilité d’un mot dépend de celui qui le prononce, non de ce qu’il signifie.
Dans un contexte progressiste, il devient provocation esthétique ; dans un autre, réflexe suspect.
Le droit pénal devient sismographe d’appartenance idéologique.
Rappelons le but de l’article 86a : empêcher la résurgence de signes totalitaires, non poursuivre leurs miroirs ironiques.
Qu’un tribunal de Berlin ait autorisé une perquisition sur cette base montre moins une rigueur juridique qu’une nervosité culturelle.
L’État perd son sang-froid dès que l’ironie vient du « mauvais » côté.
Il confond critique et contamination.
Or une démocratie qui ne supporte plus l’ironie cesse de comprendre son propre sérieux.
Quand les mêmes mots valent, selon les cas, œuvre d’art ou délit, ce n’est pas un hasard, mais un symptôme : un État qui a perdu son rapport au langage.
L’affaire Bolz n’est pas un scandale, mais un signal.
Elle montre que dans un pays qui prend son passé au sérieux, la peur du malentendu est devenue plus forte que la confiance dans le jugement des citoyens.
La liberté ne consiste pas à dire ce que tous comprennent, mais à pouvoir dire ce qui pourrait être mal compris – et que l’État, malgré cela, reste calme.
« Il punit ce qu’il subventionne, et subventionne ce qu’il punit. Ce n’est pas une double morale, mais une confusion du langage au cœur même de la démocratie – et elle nourrit le soupçon que le droit n’est plus aveugle, mais partial. »
Sources)
taz, 10 mai 1997, Doris Akrap : « Deutschland, erwache ? ».
taz, 23 octobre 2025 : « Perquisition à cause d’un tweet ».
FAZ, 23 octobre 2025 : « Perquisition au domicile de Norbert Bolz à Berlin ».
LTO, 24 octobre 2025 : « Tabou du droit pénal ou réaction excessive ? ».
Junge Freiheit, 24 octobre 2025 : « Un même mot, deux poids : Roth subventionne ce pour quoi Bolz est visé ».
En conversation : Pierre Marchand à propos de l’affaire Bolz
Théodore Maillan, du magazine politique français « Le Jour Politique », s’entretient avec Pierre Marchand sur le langage, le droit et la peur de l’ironie.
Le point de départ : le tweet de Norbert Bolz et la perquisition berlinoise.
L’entretien suit la logique de l’essai et la traduit en questions précises et réponses claires.
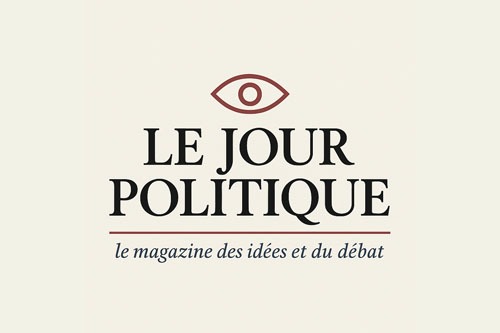
Magazine politico-analytique « Le Jour Politique » :
LE JOUR POLITIQUE : Monsieur Marchand, commençons sobrement. Un tweet de seize mots. Une perquisition à Berlin. Si vous ne regardez que la procédure, sans le bruit du débat, que voyez-vous ?
P. Marchand : Je vois une justice qui a perdu son calme. Non par hostilité à la liberté, mais par un glissement plus doux : elle cherche à protéger la démocratie en l’éduquant. Là où le droit éduque, il devient partial. Il ne juge plus l’acte, mais l’attitude.
LE JOUR POLITIQUE : La phrase « Deutschland erwache » a une histoire lourde. Le parquet berlinois invoque l’article 86a. N’est-ce pas logique ?
P. Marchand : L’origine de la formule est indiscutable. Mais le droit pénal allemand connaît l’interprétation contextuelle. L’intention est décisive. L’affirmation est punissable ; le miroir, non. Bolz n’a pas employé la phrase comme mot d’ordre, mais comme reflet d’un présent saturé de morale. Ignorer le contexte, c’est criminaliser la citation. Là se situe la ligne de protection minimale entre république libre et république pédagogique.
LE JOUR POLITIQUE : Dans votre essai, vous écrivez que l’État punit ce qu’il subventionne et subventionne ce qu’il punit. Voulez-vous dire qu’il agit de manière arbitraire ?
P. Marchand : Je parle d’une perte d’honnêteté sémantique. Le fait qu’un projet fédéral porte la même expression, subventionné par la ministre de la Culture, tandis que la même formule devient ailleurs infractionnelle, ne relève pas d’un caprice administratif, mais d’une faille structurelle. L’évaluation ne dépend plus de l’usage, mais de celui qui parle. C’est le point de bascule. Le droit devient sismographe d’appartenance idéologique.
LE JOUR POLITIQUE : Les défenseurs de la mesure diraient que la liberté artistique possède un statut particulier. Est-ce une différence légitime ?
P. Marchand : La liberté artistique est essentielle, mais elle ne dispense pas de l’examen du contexte, elle le confirme. Si une phrase peut être lue comme un travail critique dans un cadre artistique, le même critère doit valoir dans le discours public, quand l’ironie et la citation sont manifestes. Sinon, le critère glisse insensiblement du « quoi » au « qui ».
LE JOUR POLITIQUE : Vous parlez d’une « tyrannie douce du bien ». N’est-ce pas exagéré ?
P. Marchand : Je dis « douce » au sens littéral. Pas de bottes, pas de violence : une langue de bienveillance, légitimée par la protection et le respect, qui aboutit à des frontières linguistiques. Celui qui contredit paraît s’opposer au bien. Cette grammaire morale rend le droit nerveux : rien de spectaculaire, mais des effets profonds.
LE JOUR POLITIQUE : Votre référence à Orwell vient naturellement. Vivons-nous une situation orwellienne ?
P. Marchand : Nous ne vivons pas chez Orwell, mais nous parlons sa grammaire. Ce n’est pas la surveillance le centre, mais la politisation du sens. Quand la même expression change de valeur selon le locuteur, le novlangue existe déjà, sans mots nouveaux.
LE JOUR POLITIQUE : S’agit-il alors d’une justice de conviction ?
P. Marchand : Dès que l’origine et l’appartenance du locuteur pèsent plus que le contenu, oui. La justice de conviction n’a pas besoin de brutalité. C’est la forme élégante du préjugé, d’autant plus difficile à critiquer qu’elle agit au nom de la protection.
LE JOUR POLITIQUE : Que révèle cette affaire de l’Allemagne de 2025 ?
P. Marchand : Que la peur du malentendu a dépassé la confiance dans le discernement des citoyens. Une démocratie qui ne supporte plus l’ironie sous-estime son public et surcharge le droit pénal de fonctions qui relèvent de la culture et du débat.
LE JOUR POLITIQUE : Où réside, selon vous, l’erreur centrale de la décision berlinoise ?
P. Marchand : Dans la confusion entre citation et identification. Le droit pénal doit empêcher la réactivation de symboles totalitaires, non punir leurs reflets. Renoncer à cette distinction, c’est glisser de la protection de l’ordre à la pédagogie du langage.
LE JOUR POLITIQUE : Certains diront qu’il ne s’agit que d’une perquisition ; la justice enquête, elle ne juge pas encore. La réaction n’est-elle pas excessive ?
P. Marchand : La question est légitime. Mais dès le seuil de la contrainte, l’État s’arroge un droit d’interpréter l’ironie. C’est le dommage symbolique : il révèle la profondeur de la nervosité. Inutile de dramatiser ; il faut nommer précisément.
LE JOUR POLITIQUE : Un lecteur français se demandera si l’Allemagne n’est pas simplement plus sensible parce qu’elle prend son passé au sérieux.
P. Marchand : Prendre son passé au sérieux est une force. Le traduire en hygiène verbale rigide ne l’est pas. La mémoire requiert le jugement, non l’automatisme. La maturité démocratique consiste à faire confiance à la distinction des citoyens ; sinon, on apprend à éviter les mots, pas à les comprendre.
LE JOUR POLITIQUE : En France, la satire est souvent plus mordante. Voyez-vous une différence culturelle ?
P. Marchand : Oui. La satire française accepte plus de friction, au risque du cynisme. L’espace public allemand protège davantage la sensibilité, au risque de la sur-correction pédagogique. Chacun y gagne et y perd. L’affaire Bolz montre à quelle vitesse la protection devient contrôle quand on se méfie du public.
LE JOUR POLITIQUE : Venons-en à la politique. Vous dites que les impulsions de cette gestion du langage viennent aujourd’hui plutôt de la gauche. Pourquoi cela vous semble-t-il significatif ?
P. Marchand : Parce que ce courant a historiquement défendu les libertés contre la moralisation d’État. S’il tend aujourd’hui à encadrer la langue au nom de la protection, c’est une rupture dans son propre héritage : non pas hypocrisie, mais déplacement des priorités. La protection des groupes vulnérables devient valeur suprême ; mais quand la protection vire à la gestion du langage, on cède le terrain à ceux qui brandissent le mot “liberté”, même s’ils l’entendent autrement.

Théodore Maillan, du magazine politique français « Le Jour Politique », s’entretient avec Pierre Marchand au sujet du langage, du droit et de la peur de l’ironie.
LE JOUR POLITIQUE : Quelle serait la correction républicaine simple, sans grand pathos ?
P. Marchand : Trois phrases. Premièrement : le contexte avant le catalogue. Deuxièmement : l’intention avant l’apparence. Troisièmement : le calme avant la contrainte. Cela suffit pour préserver l’article 86a et éviter de criminaliser l’ironie.
LE JOUR POLITIQUE : Et si quelqu’un utilisait réellement l’expression de manière affirmative ?
P. Marchand : Alors le droit s’applique, et à juste titre. La distinction n’est pas une échappatoire, c’est sa raison d’être. Qui proclame, proclame. Qui reflète, reflète. Un État qui ne sait plus faire cette différence perd sa précision conceptuelle.
LE JOUR POLITIQUE : Votre essai se termine sur une phrase au sujet de la liberté et du malentendu. Pouvez-vous la redire ici en une seule phrase ?
P. Marchand : La liberté, c’est quand l’État reste calme, même s’il risque d’être mal compris.
LE JOUR POLITIQUE : Merci pour cet entretien.
P. Marchand : Merci à vous.




 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 © La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)
© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.) © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.