Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
Comment reconstruire la vérité lorsque chacun croit déjà la détenir ?
Un essai d’Étienne Valbreton
Rubrique : Chambre Noire / Philosophie & Actualité
« La vérité est ce qui échappe à la volonté. » – Simone Weil¹
Paul Valéry² disait que la vérité est ce qui ne s’invente pas. Une phrase qui paraît aujourd’hui presque présomptueuse, car notre époque a appris à tout inventer – y compris la vérité. Nous vivons à un temps où chaque discours proclame son propre centre, chaque groupe sa propre mesure, chaque voix sa propre évidence. Le conflit ne porte plus sur les choses elles-mêmes, mais sur leur interprétation : chacun tire sur le sens jusqu’à ce qu’il se rompe. La vérité est devenue une masse, trop abondante, et par là méconnaissable.
Qui en doute n’a qu’à regarder dans les miroirs numériques. La même scène, la même phrase, le même chiffre – et pourtant naissent cinq réalités entièrement différentes. Un tweet que l’un brandit comme preuve est lu par l’autre comme manipulation³. La question n’est plus ce qui s’est passé, mais comment on doit le lire.
Dans la première domine le sentiment : la réalité affective, où l’indignation et l’adhésion remplacent l’analyse.
La deuxième est idéologique : les faits ne servent plus à vérifier, mais à confirmer l’appartenance.
La troisième est économique : les algorithmes et les marchés de l’attention décident de ce qui devient visible et donc réel.
La quatrième est narrative : ce sont les récits, non les faits, qui donnent sens – la réalité suit la dramaturgie.
Et la cinquième est scientifico-technique : elle revendique l’objectivité tout en suscitant la méfiance ; ses données sont perçues à la fois comme vérité et comme tromperie. Nous croyons aux chiffres, mais non aux mains qui les produisent. Entre confiance dans la méthode et peur de la machine naît une confusion nouvelle : les données sont crues comme des oracles, contestées comme des prophéties.
Cinq réalités coexistent, se recoupent et s’annulent. La vérité ne se brise pas sur le mensonge, mais sur la profusion de ses reflets.
Comment alors reconstruire ce qui n’a jamais été entier ? La vérité n’a jamais été un bien, mais une relation : entre l’observateur et le monde, entre le mot et la chose, entre l’expérience et la mémoire. Ce que nous avons perdu, ce n’est pas la vérité elle-même, mais la capacité de la concevoir comme un travail commun.
Aujourd’hui, on la proclame comme un titre de propriété. Dans les arènes numériques, tous crient à la fois : je l’ai, je la connais, je la défends. Il en résulte un vacarme sans tonalité, où chaque voix a raison pourvu qu’elle soit assez forte. La vérité vaut par confession et non plus par vérification⁴. Elle se proclame avant d’être découverte. La formule du siècle est : je ressens, donc c’est vrai.
Comment alors reconstruire ce qui s’est ainsi dissipé ? Peut-être en séparant à nouveau la vérité du sujet. La vérité a la forme d’un chemin ; elle se parcourt, elle ne se possède pas. Son but n’est pas la victoire, mais la compréhension.
Reconstruire ne signifie pas revenir à un état perdu, mais exercer un travail de vérité : l’examen conscient de sa propre perception dans l’échange avec autrui⁵. Elle se rapproche de l’agir communicationnel chez Habermas, mais vise moins le consensus que la lucidité.
La reconstruction demande de l’humilité. Elle commence par la conscience que l’on ne détient que des fragments : éclats de discours, images muettes, données trop bruyantes. La vérité naît là où l’oreille reste ouverte au discret, où le doute a voix, où écouter devient penser.
Peut-être ce travail de vérité commence-t-il au moment où une réponse prend plus de temps qu’une réaction. Celui qui, face à une attaque numérique, ne réagit pas aussitôt mais vérifie si le propos tient, accomplit déjà la forme la plus simple de ce travail. Écouter, ici, c’est interrompre le réflexe, loger la pensée dans l’instant qui, sans cela, deviendrait indignation.
Mais écouter n’est pas fuir l’espace public. C’est une attitude à pratiquer au cœur même du vacarme : maintenir la conversation ouverte, même lorsque les mots deviennent lourds. La vérité naît de la résistance à la tentation de n’entendre que soi-même.
L’historien, l’archéologue, le juge, le médecin – tous travaillent à partir de traces. Ils savent qu’une trace n’est jamais identique à l’événement. Leur art consiste à faire surgir un sens sans trahir la trace. La vérité, en ce sens, n’est pas un état, mais une pratique de l’attention⁶.
On retrouve encore cette attitude dans l’art. La véritable image n’est pas celle qui a raison, mais celle qui demeure ouverte. Un tableau qui nous force à regarder de plus près enseigne plus sur la vérité qu’un éditorial qui nous dit quoi penser.
Byung-Chul Han décrit notre époque comme une société de la transparence, où tout est visible mais presque rien n’est vrai⁷. Or la vérité a besoin d’opacité – du droit à ne pas tout montrer. Comme le remarque Sloterdijk, les Lumières connaissent leur propre cynisme⁸ : elles savent tout et ne croient plus à rien. La vérité, au contraire, exige une foi sans possession – la disposition à faire confiance sans dominer.
Reconstruire, c’est retrouver la capacité du travail de vérité. Elle requiert trois vertus : la mémoire, la critique et le silence. La mémoire, c’est se souvenir aussi de ce qui dérange ; la critique, c’est examiner sa propre mesure avant de juger ; le silence, c’est supporter la pause où quelque chose de nouveau prend forme⁹.
Ces vertus peuvent se vivre, même hors de la philosophie. Dans la vie quotidienne : vérifier les sources, accepter la contradiction, ne pas absolutiser son propre jugement. En politique : défendre la lenteur des arguments contre la hâte des slogans. En éducation : créer des espaces où penser n’exige pas l’approbation. La vérité vit de l’exercice : patience dans la pensée, écoute de l’autre, courage du doute.
« Celui qui croit déjà posséder la vérité cesse de la mériter. »
C’est peut-être la dernière forme d’Aufklärung qui nous reste : ne pas proclamer la vérité, mais la chercher sans cesse – contre la paresse, contre la séduction de l’univocité, contre le doux poison de la certitude morale.
On pourrait objecter que la vérité ne s’éprouve pas dans la conversation mais dans la réfutation. Popper voyait dans toute connaissance une hypothèse provisoire ; Foucault, dans toute vérité, un dispositif de pouvoir. Les deux ont raison : la vérité reste toujours conditionnelle – par l’erreur, par l’histoire, par le regard de l’autre. C’est pourquoi elle doit être pensée comme mouvement, non comme propriété.
Sources citées et consultées
- Simone Weil, La pesanteur et la grâce, Paris 1947.
- Paul Valéry, Tel Quel, Paris 1943.
- Observation exemplaire des médias sociaux, voir Reuters Institute, Digital News Report 2024.
- Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte [De l’origine et du but de l’histoire], Munich 1949.
- Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns [Théorie de l’agir communicationnel], Francfort 1981.
- Hannah Arendt, Truth and Politics, The New Yorker, 1967.
- Byung-Chul Han, Transparenzgesellschaft [La société de la transparence], Berlin 2012.
- Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft [Critique de la raison cynique], Francfort 1983.
- Étienne Valbreton, Les Ombres du visible, Paris 2023.




 © La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)
© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)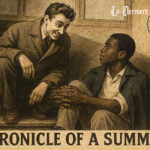 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Markus Lüpertz Porträtkarikatur

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.