![]()
Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
François Grosdidier – l’artisan de Metz
Un portrait
Unbequeme Stimmen
Note sur la série de portraits
Il existe un désir silencieux d’approbation. Politique, médias, culture – tous aiment l’unisson,
la mélodie bien tempérée qui ne fait de mal à personne. Mais une société qui ne chante qu’en chœur perd ses voix.
Les figures les plus intéressantes sont souvent celles qui refusent de chanter avec les autres. Elles sont gênantes, rugueuses, parfois éprouvantes.
Elles troublent le consensus et risquent l’isolement. Mais c’est précisément là que réside leur importance : elles nous rappellent
que la liberté ne se trouve pas dans les applaudissements, mais dans la contradiction.
La Dernière Cartouche s’empare de ces voix. Non pas pour les célébrer, ni pour les condamner –
mais pour les comprendre. Nous dressons le portrait de personnalités qui ont leur propre opinion et ne la cachent pas.
Des individus qui, dans un climat d’harmonisation, ont le courage de nager à contre-courant.
Les trois premiers portraits montrent l’ampleur de ce type :
- Wolfram Weimer, l’architecte de l’opinion publique, qui construit les médias comme d’autres bâtissent des maisons et croit à la force des symboles.
- Boris Palmer, le maire en pleine tempête, qui conçoit la politique comme un artisanat et n’a pas peur des tabous.
- Henryk M. Broder, l’épine dans la chair, qui par l’ironie et la polémique tranche toute forme de confort.
Trois voix, trois biographies, trois styles – réunis par une chose : ils ne se laissent pas récupérer. Ils sont dérangeants.
Et c’est précisément cela qui les rend intéressants pour nous.
Car une société qui perd de telles figures perd aussi sa culture du débat. Et sans débat, il n’y a pas de liberté.
François Grosdidier – l’artisan de Metz
Par Pierre Marchand
Lorsque François Grosdidier a pris en main les destinées de sa ville natale en juillet 2020, Metz se trouvait à un moment délicat. L’éclat du Centre Pompidou s’était estompé, les finances étaient tendues, la ville en transition. Quatre ans plus tard, le constat est clair : l’homme qui avait marqué la mairie de Woippy n’a pas seulement administré Metz. Il l’a transformée.
Du soldat de l’Armée de l’air au maire
Né en 1961 à Metz, fils d’un ingénieur de la sidérurgie et petit-fils d’un historien, Grosdidier a grandi dans une région marquée par le déclin des hauts-fourneaux. Après une scolarité difficile, il s’engage dans l’Armée de l’air, sert à Djibouti, vit de petits emplois. Plus tard seulement, il revient à l’université, étudie le droit public et fait ses premiers pas dans l’administration communale.
Très tôt, il s’implique en politique. Dès l’âge de douze ans, il colle des affiches pour Jean Kiffer à Amnéville, puis rejoint rapidement le RPR de Jacques Chirac. En 1993, il entre à l’Assemblée nationale comme l’un des plus jeunes députés. Il perd son siège, mais trouve son ancrage à Woippy : maire pendant près de vingt ans, il rénove le logement social, renforce la police municipale, attire de nouveaux habitants. Woippy lui doit sa stabilité.
En 2020, Metz le choisit enfin comme maire. C’est le retour dans sa ville natale – et le début d’une nouvelle étape où Grosdidier met son expérience de pragmatique au service de la cité.
Des projets qui marquent le paysage urbain
La Serpentine
Rien ne symbolise davantage son mandat que la Serpentine. La structure ondoyante entre la rue Serpenoise et la rue Ladoucette reprend la forme du Graoully, le dragon légendaire de Metz. Arcs métalliques, îlots végétalisés, assises, fontaine d’eau, alcôve sonore – un mélange de mobilier urbain, d’œuvre d’art et de symbole.
« Nous voulons redynamiser le commerce, redonner de l’attractivité et créer un cadre de vie agréable. » (François Grosdidier)
La Serpentine n’a pas pour seule vocation de décorer, mais de ramener la vie dans un centre frappé par la vacance commerciale et la concurrence. Ses détracteurs dénoncent le coût – de 2,5 millions d’euros prévus à près de 6 millions aujourd’hui –, mais Grosdidier défend l’investissement :
« Je conteste des critiques totalement injustifiées. »
Qu’on l’aime ou non, la Serpentine est une rupture : elle change le visage du centre-ville et s’inscrira dans la durée.
Une mobilité pour une ville en mouvement
Les transports portent également sa marque. À l’été 2025, l’extension de la ligne A du METTIS jusqu’à l’Hôpital Robert Schuman a été inaugurée – avec de nouveaux arrêts, des pistes cyclables, une meilleure desserte des grands pôles de santé et d’emploi. Auparavant, la ligne C vers Marly avait été lancée, et une autre liaison est déjà prévue.
Grosdidier envoie ainsi un signal clair : Metz doit réduire sa dépendance à la voiture. Pistes cyclables, réaménagement des carrefours, fréquence accrue des transports en commun – autant de mesures qui modifient le quotidien et favorisent une nouvelle culture de la mobilité.
Sécurité et ordre
En matière de sécurité, Grosdidier suit une double stratégie : présence visible et prévention. La police municipale a été renforcée de 25 %, de nouvelles unités créées – à vélo, avec chiens, spécialisées dans la circulation. En parallèle, le réseau de caméras s’étend : jusqu’à 1 000 doivent être installées.
Pour certains, Metz devient ainsi plus sûre, pour d’autres une ville sous surveillance permanente. Grosdidier y voit un devoir, non un simple outil : « Les habitants doivent avoir le sentiment d’être protégés. »
Culture et attractivité
Metz vit aussi de ses fêtes. Grosdidier n’a pas seulement préservé les traditions, il les a renforcées. Le Marché de Noël a été réorganisé, les illuminations amplifiées, les places mieux mises en valeur. Metz reste ainsi un pôle d’attraction en période de l’Avent, avec un impact économique pour le commerce et la restauration.
L’offre estivale a également été enrichie : Constellations, fête de la Mirabelle, nouveaux formats comme Bellissimetz ou la Fête de l’Eau. Le message est clair : Metz doit se montrer – à ses habitants, mais aussi aux visiteurs de la région et aux touristes.
Économie, agriculture, industrie
Grosdidier sait qu’une ville ne vit pas de culture seule. Comme président de l’Eurométropole, il impulse des programmes pour l’économie locale : soutien aux PME, promotion des circuits courts, investissements dans l’innovation et la formation.
Avec la signature de la charte ADAGE, Metz s’engage à introduire davantage de produits locaux et biologiques dans les cantines publiques – un gain pour les agriculteurs et producteurs du territoire. De nouvelles écoles, comme l’Institut d’ingénierie logistique (I2L) au Technopôle, rapprochent industrie et formation et garantissent les compétences de demain.
Son pragmatisme se voit aussi dans le budget : pas d’illusions coûteuses comme la gratuité totale des transports, mais des pas finançables, capables de transformer la ville progressivement.
Le style de « l’hypermaire »
Certains l’appellent « hypermaire » – omniprésent, médiatique, sans cesse sur les places de la ville. C’est en réalité sa méthode. La visibilité crée la confiance, et Grosdidier est un maire qui préfère agir plutôt qu’hésiter.
« La foule était au rendez-vous pour assister à ce moment historique. » (à l’inauguration de la Serpentine)
Son style n’est ni raffiné ni intellectuel. Il est concret, direct, parfois rude. Mais à une époque où la politique se dissout trop souvent dans l’indétermination, il privilégie le tangible : de nouvelles rues, de nouvelles lignes de bus, la lumière, la sécurité, les fêtes.
2026 – l’épreuve
Les élections municipales ont été avancées au printemps 2026. Grosdidier dispose de peu de temps pour convaincre les sceptiques. Il mise sur son bilan : mobilité, sécurité, aménagement urbain, culture, économie.
Son risque : des finances tendues, des projets contestés, des attentes immenses. Son atout : des traces visibles, des changements indéniables. Metz n’est plus une ville figée.
François Grosdidier n’est ni magicien, ni grand orateur. Il est artisan. Il construit, façonne, pousse en avant. Metz a retrouvé sous lui un nouvel élan – avec des projets discutés, mais impossibles à ignorer.
Et c’est peut-être précisément ce dont la ville avait besoin en ces années : non pas d’un rêveur, mais d’un homme qui laisse des traces.



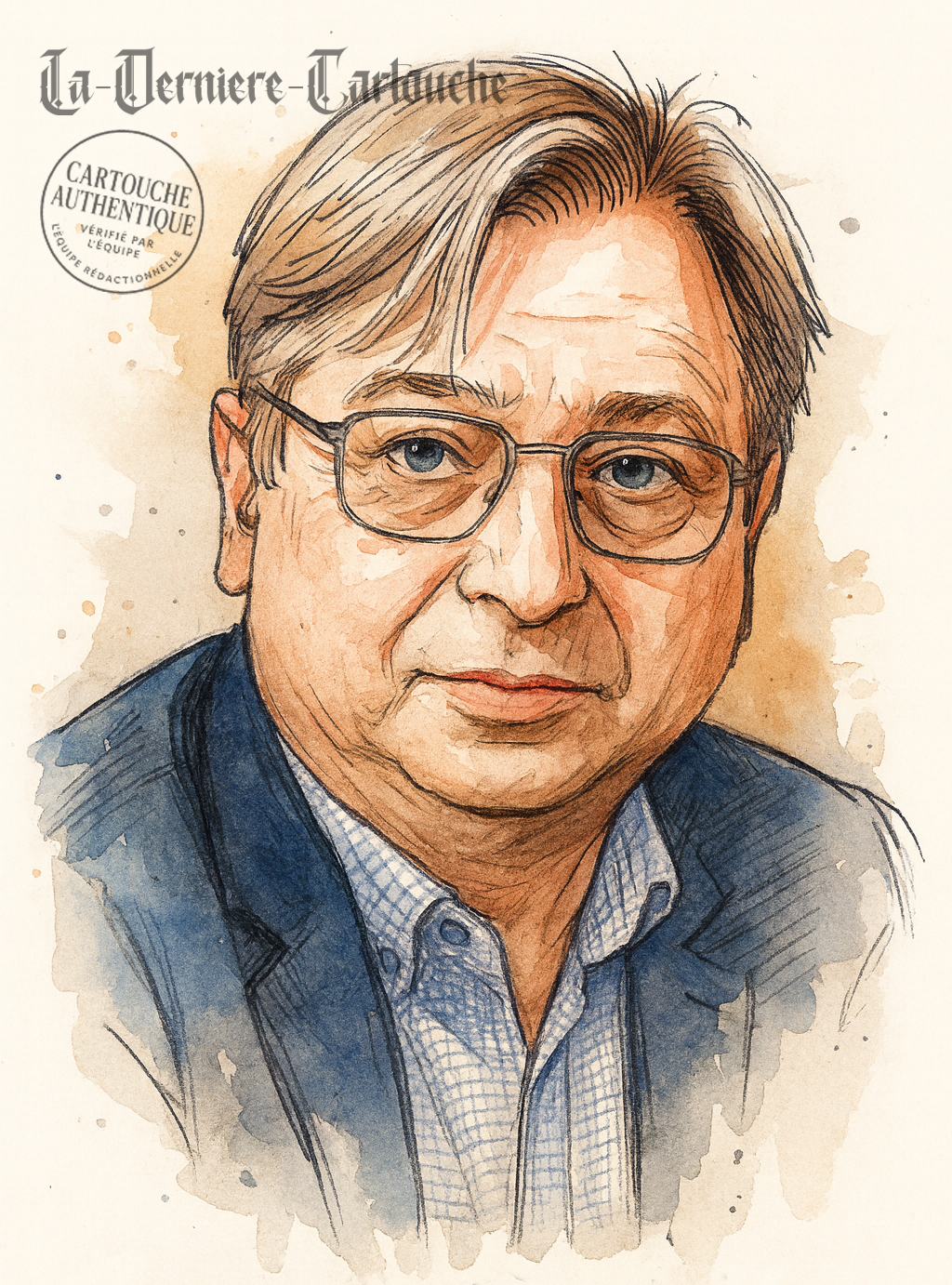
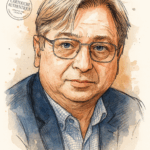 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.