![]()
Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
Antimilitarisme aujourd’hui
Du tabou au serment de loyauté ?
Le refus de la guerre est devenu un signe de défiance. Aujourd’hui, celui qui hésite à livrer des armes ou qui remet en question la notion de “capacité de défense” est vite soupçonné de minimiser la menace ou de trahir une cause. Ce glissement dans les coordonnées morales de notre époque n’est pas anodin. Il témoigne d’un retournement historique : l’antimilitarisme n’est plus perçu comme une forme de vigilance politique, mais comme une absence de loyauté.
Et pourtant, le refus de la guerre fut jadis un fondement européen. Après deux guerres mondiales, une culture de la mémoire s’est formée qui considérait la guerre comme un échec. Ossietzky n’écrivait pas pour être acclamé. Tucholsky ne prévenait pas pour avoir raison. Tous deux savaient que le pacifisme, face à la montée de la violence, n’est ni lâcheté ni fuite, mais lucide clairvoyance. Aujourd’hui, cet héritage semble décoloré, à peine visible, parfois même moqué.
Le discours s’est refermé sur lui-même. La politique de défense n’est plus affaire d’arguments, mais de consentement. Là où l’on demandait autrefois si la guerre était inévitable, on acclame aujourd’hui ceux qui affichent leur “fermeté”. Dans les écoles aussi, ce ton nouveau s’impose. L’armée entre dans les classes, l’uniforme devient pédagogique. Peu s’interrogent sur ce que cela transmet vraiment.
En même temps, la peur est attisée. Il faut s’armer, dit-on, pour ne pas laisser le temps à Poutine. Le discours est martial, presque rituel : qui doute mettrait en danger la nation. Pendant que l’on se prépare psychologiquement à une guerre de défense, une autre réalité est peu évoquée : la Russie mène depuis trois ans une guerre d’usure sans percée territoriale nette. La situation est grave, certes, mais pas nouvelle. Le discours a pris le pas sur les faits.
Un autre facteur s’ajoute : l’économie. Tandis que l’industrie automobile souffre des politiques climatiques, le secteur de l’armement devient un nouvel axe de croissance. On parle de “transformation” et de “résilience”. En vérité, on réarme parce qu’ailleurs on désarme. Il ne s’agit pas d’éthique, mais de logique d’investissement.
Dans l’espace public, l’asymétrie est manifeste. On manifeste pour Israël, pour le climat, pour les droits. Mais qui s’oppose encore à l’armement ? Qui questionne la militarisation des esprits ? Qui refuse l’habitude de la force comme réponse politique ? Les défilés pour la paix sont devenus rares, presque suspects. Dire non exige justification, comme s’il fallait s’excuser de ne pas vouloir de fusils.
Et pourtant, ce non reste nécessaire. Ni absolu, ni niais, ni confortable. Mais présent, comme mémoire d’une autre voie. En temps de guerre, ce qui meurt en premier n’est pas la vérité, mais la foi en une autre issue. L’histoire a connu bien des formes de courage. L’antimilitarisme fut l’une d’elles. Il le demeure, tant que quelqu’un ose encore le prononcer.
Dire non n’est pas fuir. C’est commencer autrement.






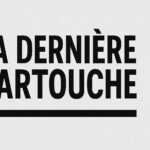 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.