![]()
Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
Zu Pankaj Mishra: Die Welt nach Gaza, 2025
Darüber müssen Bibliotheken geschrieben werden
Christof Sperl et son article sur Pankaj Mishra
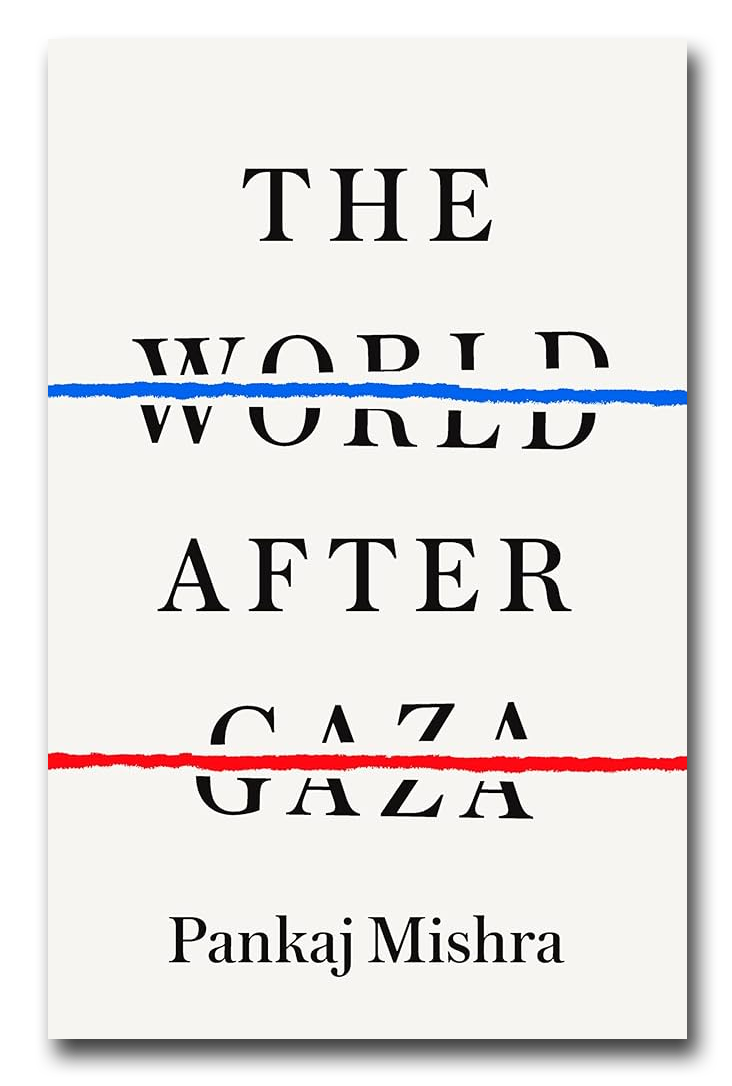
À une époque où les conflits géopolitiques continuent de bouleverser le monde, l’éminent critique culturel et auteur Pankaj Mishra se lance dans une analyse approfondie des causes de la violence et de l’oppression au Moyen-Orient dans Le Monde après Gaza (2025). Mishra y mêle des perspectives historiques et postcoloniales pour explorer les racines du conflit. Mais les réactions à cet ouvrage soulèvent également des questions passionnantes — des questions auxquelles Christof Sperl consacre son article.
Sperl, diplômé en romanistique et en études anglaises, se penche dans son texte sur l’analyse du conflit de Gaza par Mishra et interroge l’applicabilité universelle de ses thèses postcoloniales. Il met en lumière les voix critiques dans le monde occidental et examine dans quelle mesure la perspective de Mishra parvient à saisir pleinement la complexité du conflit. Alors que l’auteur rencontre souvent l’adhésion dans son traitement des dimensions politiques et historiques du conflit, ses comparaisons entre Gaza et d’autres formes d’oppression — comme l’apartheid ou le racisme américain — suscitent également des réactions controversées.
Dans cet article, Sperl remet en question l’efficacité des arguments de Mishra, examine les diverses réceptions de l’ouvrage et interroge comment Mishra lui-même évalue de manière critique la manière dont l’Occident traite les mémoires historiques et les rapports de force géopolitiques actuels.
Il pourrait sembler naturel d’étendre la critique du sociologue W.E.B. Du Bois (1868-1963) à la société américaine, avec ses mécanismes de séparation encore aujourd’hui très marqués, et de l’appliquer à d’autres régions du monde. Il serait alors possible de se demander si ces mécanismes sont soumis à des lois universelles pouvant être appliquées à des conflits culturels en dehors des conditions américaines. C’est précisément ce que fait l’auteur primé et critique culturel Pankaj Mishra. La question de savoir si ses résultats sont valables, compréhensibles et raisonnables pour le Moyen-Orient fait l’objet de cette analyse.
Mishra (*1969 à Jhansi, Inde) a, par ses travaux précédents (par exemple L’Âge de la colère, 2017), prouvé qu’il accorde une attention particulière aux thèmes de la guerre, de la haine et de la violence, qui constituent des développements de plus en plus menaçants pour la planète. Qu’il s’agisse des attentats du groupe État islamique, du nationalisme exacerbé, du racisme, du poison misogyne dans les réseaux sociaux, des attaques et des tueries en milieu urbain, Mishra cherche les causes de ces forces destructrices. Ainsi, il serait injustifié de lui reprocher de vouloir ignorer ou minimiser les massacres, viols et prises d’otages du 7 octobre 2023 dans le cadre du conflit de Gaza, simplement parce qu’il écrit de manière critique sur le monde après Gaza. Peut-être que Mishra a choisi ce terme “après Gaza” parce que Gaza sous sa forme actuelle pourrait bientôt n’exister plus.
Dans son dernier ouvrage Le Monde après Gaza (2025), Mishra aborde les évolutions historiques qui ont conduit à ce conflit permanent, et, malheureusement, qui continueront longtemps. La quantité de perspectives et de matériaux que Mishra rassemble dans son ouvrage est à la fois déroutante et fascinante. J’ai lu ce livre avec un crayon, prenant des notes et marquant des passages. Mon exemplaire a été annoté en une semaine, un phénomène rare dans ma vie. Il n’est souvent possible d’atteindre cela que lorsqu’un texte est véritablement bouleversant. Bien sûr, je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il dit, comment cela pourrait-il être autrement ? Les livres sont des leçons, ils offrent des facettes de la réflexion que l’on peut s’approprier, mais sans obligation.
En fin de compte, pour Mishra, la violence est une catastrophe qui, pour le Moyen-Orient, a des causes qui doivent être examinées principalement sous l’angle de la pensée postcoloniale et de ses structures. Nous voici déjà dans la critique bipartite qui le remet en question sur son impartialité, ce que certains ne croient pas. Le journal Die taz parle d’une “drogue toxique”, affirmant que le livre occulte certains aspects contraires à la lecture postcoloniale. Le Parlement parle de “compte-rendu”.
Le Neue Zürcher Zeitung (NZZ), déjà allergique au terme postcolonial dans son ADN, écrit que “ce livre est mauvais”, bien qu’il puisse être informatif, intéressant et éducatif. Le travail de Mishra constitue une “anthologie de la perception postcoloniale du monde”, une vision que ce journal craint de confier à qui que ce soit sans responsabilité.
Une critique de l’ORF reconnaît pourtant “la nécessité d’une narration multiperspective”, tandis que Matthias Bartsch de la radio publique allemande dlf évoque l’indifférence de l’Occident face à la souffrance au Moyen-Orient, où toutes les tentatives de pacification échouent. Il déplore également des “passages discutables et irritants” chez Mishra.
Il est, en effet, pour de nombreux observateurs extrêmement problématique d’accepter la comparaison de Mishra entre Gaza, le racisme américain, le ghetto de Varsovie et l’apartheid sud-africain. Cependant, pour ceux qui ne sont pas directement concernés par le conflit, la position des humanistes israéliens et/ou juifs, qui critiquent eux-mêmes de manière répétée l’État d’Israël, reste essentielle. Ces voix apportent certainement une réflexion utile pour enrichir notre propre perception du conflit de Gaza, souvent observé sous un prisme armé.
Mishra revient sans cesse dans son ouvrage, qui est aussi remarquable sur le plan linguistique et littéraire, sur l’image de Moshe Dayan, un homme politique dont le portrait était autrefois accroché dans la chambre de Mishra durant sa jeunesse. Au début, il admirait ce leader déterminé, reconnaissable à son œil manquant, mais au fil du temps, son opinion sur lui est devenue de plus en plus critique. Cette image de refuge a radicalement changé. Les conflits dans cette histoire suivent, pour Mishra, une ligne de couleur (d’après Du Bois “The color line”), qui divise l’humanité entre “Blancs” et “Couleurs”, les Blancs exerçant toujours le pouvoir. Cette division devient une ligne de conflit, aussi au Moyen-Orient. Mishra prend la parole au nom des opprimés du “Sud global”, qui doivent s’emparer de leurs droits dans le cadre d’une lutte de libération solidaire. L’ouvrage prend ici un ton militant. Le terme de “Sud global” est à mon avis trop grossier et englobe trop de cultures diverses sous une dénomination floue. Mishra soutient sa thèse des couleurs avec une quantité impressionnante de détails qui n’a pas son égal, mais parfois cela mène à une vision extrêmement négative des réalités israéliennes. J’aurais aimé que Mishra, à côté des références ubiquistes aux membres de la droite radicale au sein du gouvernement israélien, évoque aussi les grands mouvements au sein de la population israélienne, qui manifestent presque quotidiennement pour mettre fin au conflit, libérer les otages vivants et lutter contre la brutalité de certaines branches du gouvernement. Les récents rapports et leur étouffement par l’Occident font douter chaque jour de la possibilité d’un apaisement. Nous connaissons probablement quelques citations qui vont à l’encontre de l’espoir d’une détente.
Dans ma longue carrière professionnelle, j’ai eu l’occasion de connaître et d’apprécier des Palestiniens et des Israéliens comme collègues, qui m’ont fait part de leurs points de vue. Il y a peu de temps, j’ai été invité à une rencontre entre amis proches, où la situation a failli dégénérer. Une personne présente (seuls quelques-uns le savaient) avait été directement touchée par les événements du 7 octobre, et un débat politique a éclaté. Un enseignant présent est parvenu, par son approche pédagogique et professionnelle, à désamorcer le conflit. Cela montre bien que la situation nous concerne tous, en Allemagne, non seulement à cause de la migration et de notre histoire récente, mais aussi à chaque instant.
À ce moment-là, il devient nécessaire de décrire ce que Mishra reproche parfois à l’Allemagne. Car cet ouvrage porte aussi sur notre propre histoire récente, que M. Gauland a tenté de minimiser il y a quelque temps. Mishra parvient à expliquer comment, après une dénazification superficielle, qui n’a jamais vraiment eu de force cathartique, la mémoire de l’Holocauste est devenue une pratique figée et autocentrée. Si des figures comme Fritz Bauer n’avaient pas existé, encore moins de criminels de guerre auraient été jugés, et plus d’entre eux auraient poursuivi leur carrière dans la justice et la politique de la jeune République fédérale. Des familles cachent encore leurs complicités à ce jour (titre récent du SPIEGEL numéro 19/25: “Le tabou allemand”). Pour Mishra, la culture de la mémoire nous permet d’évacuer facilement notre propre culpabilité, en nous associant aux “bons”, tout en négligeant leurs actes, y compris les actions actuelles, et en ignorant la souffrance des habitants de Gaza qui ne sont pas liés à Hamas.
Peu de choses ont été entendues de l’extrême droite en Allemagne concernant Mishra et le Moyen-Orient. Cela pourrait être dû au fait que le carré de forces entre Trump et sa politique étrangère, le rejet global de l’islam, l’histoire allemande et la tradition de l’antisémitisme de droite sont trop contradictoires.
Les preuves de Mishra sont nombreuses, notamment des auteurs célèbres, mais aussi moins entendus, et des partisans de la cause israélienne tels que la philosophe Hannah Arendt (dont la relation dramatique avec Heidegger nous revient en mémoire) ou le chimiste et écrivain Primo Levi, dont l’expérience d’Auschwitz est bien connue. Mishra cite des sources qui montrent leur critique marquée de la politique de Gaza d’Israël, une position qui est à peine perceptible dans le débat public. Ils ne sont pas seuls. Mishra a minutieusement rassemblé tout ce qui est utile à ses arguments, son registre (sans références complémentaires) compte huit pages très denses. Comme mentionné, certains critiques lui reprochent d’avoir omis trop de choses, ce qui affaiblirait sa position. D’autres apprécient la richesse des réflexions que l’ouvrage offre lorsqu’on en parle publiquement. Dans tous les cas, il est précieux de pouvoir voir les choses au-delà de la “bulle occidentale” dans laquelle nous, peut-être, nous enfermons parfois.
Pour mon vieux professeur de linguistique, il n’y avait pas de sujet irrecevable en science. Les modèles de pensée devaient toujours être réexaminés. Il fallait aussi lire ce que l’on ne trouvait pas juste. Le savoir ne s’arrêtait jamais — il devait être constamment révisé. L’histoire des sciences se prenait au sérieux. Le savoir se développait (selon Kuhn) à travers des changements de paradigmes, sans fin prévisible, et les connaissances d’aujourd’hui étaient les erreurs de demain. Son slogan préféré et motivant constitue également le titre de ce texte : “Il faut écrire des bibliothèques à ce sujet”. Comme c’est vrai.
Anmerkungen zur Übersetzung (linguistisch-literarisch)
1. „Es könnte naheliegen, die Kritik des Soziologen W.E.B. Du Bois (1868-1963) an der US-amerikanischen Gesellschaft mit ihren noch heute scharf trennenden Mechanismen auf weitere Teile der Welt auszuweiten“
-
Französisch: Il pourrait sembler naturel d’étendre la critique du sociologue W.E.B. Du Bois à la société américaine, avec ses mécanismes de séparation encore aujourd’hui très marqués, et de l’appliquer à d’autres régions du monde.
-
Erklärung:
Die Formulierung „Il pourrait sembler naturel“ ist eine elegante Art, einen hypothetischen Gedanken einzuführen und gleichzeitig einen gewissen Abstand zu wahren. Im Französischen wird diese Ausdrucksweise häufiger verwendet, um eine komplexe, philosophische Diskussion einzuleiten, ohne sofort eine klare Position zu beziehen. Die Formulierung „avec ses mécanismes de séparation encore aujourd’hui très marqués“ klingt im Französischen natürlicher und präziser, um die anhaltende Relevanz der sozialen Trennung zu verdeutlichen. Sie entspricht auch der französischen Präferenz für eine präzise, klar strukturierte Darstellung sozialer und politischer Phänomene.
2. „Mishra verbindet dabei historische und postkoloniale Perspektiven, um die Wurzeln des Konflikts zu ergründen“
-
Französisch: Mishra y mêle des perspectives historiques et postcoloniales pour explorer les racines du conflit.
-
Erklärung:
Die Verwendung des Verbs „mêler“ (mischen) statt „relier“ (verbinden) betont im Französischen die komplexe, tiefgehende Verknüpfung verschiedener Perspektiven und bietet eine präzisere Beschreibung des Prozesses, den Mishra verfolgt. In der französischen Sprache ist es üblicher, den interdisziplinären Ansatz, den Mishra verfolgt, als „mêler“ oder „fusionner“ darzustellen, was die Vielfalt und das Ineinandergreifen der Perspektiven unterstreicht.
3. „Sperl, Diplom-Romanist und Anglist, geht in seinem Beitrag auf Mishras Analyse des Gaza-Konflikts ein und hinterfragt die universelle Anwendbarkeit seiner postkolonialen Thesen“
-
Französisch: Sperl, diplômé en romanistique et en études anglaises, se penche dans son texte sur l’analyse du conflit de Gaza par Mishra et interroge l’applicabilité universelle de ses thèses postcoloniales.
-
Erklärung:
Das Wort „diplômé“ ist eine gängige Bezeichnung in französischen akademischen Kontexten und hebt die akademische Qualifikation von Sperl hervor, was im französischen Sprachgebrauch etwas formeller und respektvoller klingt als die deutsche Bezeichnung „Diplom-Romanist“. „Se pencher sur“ wird oft verwendet, um zu zeigen, dass sich jemand intensiv mit einem Thema beschäftigt. Es ist eine idiomatische Wendung im Französischen, die eine tiefere, detaillierte Auseinandersetzung mit einem Thema verdeutlicht.
4. „Doch auch die Reaktionen auf dieses Werk werfen spannende Fragen auf – und genau diesen Fragen widmet sich Christof Sperl in seinem Artikel“
-
Französisch: Mais les réactions à cet ouvrage soulèvent également des questions passionnantes — des questions auxquelles Christof Sperl consacre son article.
-
Erklärung:
Der Ausdruck „soulèvent des questions passionnantes“ ist eine gängige französische Formulierung, die im Französischen mehr Gewicht auf das „Erheben von Fragen“ legt und weniger abstrakt als die deutsche Formulierung klingt. Der Begriff „passionnantes“ (spannend, fesselnd) wirkt im Französischen auch etwas stärker, was die Bedeutung der Fragen, die Mishra aufwirft, hervorhebt.
5. „Die NZZ, zurückschreckend, schon aufgrund ihrer DNA hochallergisch gegen den Begriff des Postkolonialismus“
-
Französisch: Le Neue Zürcher Zeitung (NZZ), déjà allergique au terme postcolonial dans son ADN, écrit que “ce livre est mauvais”
-
Erklärung:
Die Verwendung von „allergique“ ist eine sehr passende, wenn auch metaphorische, Darstellung im Französischen, die oft verwendet wird, um starke, abwehrende Reaktionen zu beschreiben. Die Wendung „dans son ADN“ verleiht der Aussage mehr Bildhaftigkeit und Tiefe. Der Begriff „postcolonial“ ist in Frankreich eher kontrovers, und daher ist diese metaphorische Darstellung effektiv, um die vehemente Ablehnung seitens der NZZ zu verdeutlichen.
6. „Immer wiederkehrend berichtet Mishra in seinem für mich auch sprachlich-literarisch beachtenswerten Werk das Bild des Politikers Mosche Dajan“
-
Französisch: Mishra revient sans cesse dans son ouvrage, qui est aussi remarquable sur le plan linguistique et littéraire, sur l’image du politicien Moshe Dayan.
-
Erklärung:
Die Formulierung „revient sans cesse“ (kehrt immer wieder zurück) wurde gewählt, um die kontinuierliche Wiederholung von Moshe Dayans Bild in Mishras Werk klar zu betonen. Im Französischen verwendet man oft „revenir sans cesse“ für wiederkehrende Themen oder Motive. Die Struktur „qui est aussi remarquable sur le plan linguistique et littéraire“ ist eine leicht modifizierte Version, um die Bedeutung der sprachlichen und literarischen Qualitäten von Mishras Werk für den französischen Leser zu betonen.
Zusammenfassung der Anpassungen:
-
Sprachfluss und Ausdruck: Die Übersetzung wurde so gestaltet, dass sie den französischen Leser mit einem klaren, eleganten und präzisen Stil anspricht, der die französische Literaturtradition und philosophische Diskussionen berücksichtigt.
-
Kulturelle Feinheiten: Bestimmte Begriffe wie „mêler“, „allergique“ oder „se pencher sur“ sind idiomatisch für den französischen Sprachgebrauch und verstärken die Tiefe und Präzision des Textes.
-
Philosophische und literarische Nuancen: Die Anpassungen berücksichtigen den französischen Stil in der Auseinandersetzung mit politischen und historischen Themen und tragen zu einem fließenderen, poetischeren Ton bei, der auch in akademischen oder literarischen Diskussionen üblich ist.

Pankaj Mishra
Pankaj Mishra – Biographie de l’auteur
Pankaj Mishra (*1969 à Jhansi, Inde) est un essayiste, romancier et critique littéraire de renom, connu pour ses analyses profondes de la scène politique et culturelle mondiale.
Après ses études de littérature anglaise à l’Université Jawaharlal Nehru à New Delhi, il s’installe en 1992 dans le village himalayen de Mashobra, où il commence à rédiger des essais littéraires et des critiques.
Son premier livre, Butter Chicken in Ludhiana: Travels in Small Town India (1995), est un récit de voyage qui décrit les changements sociaux et culturels en Inde dans le contexte de la mondialisation.
Son roman The Romantics (2000), une narration ironique sur des personnes à la recherche de l’accomplissement dans d’autres cultures, a été publié en onze langues européennes et a remporté le Los Angeles Times Art Seidenbaum Award pour les premiers romans.
Le livre de Mishra From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia (2012) a été récompensé par le Crossword Book Award et explore les réactions des intellectuels asiatiques face à l’impérialisme occidental du XIXe et du début du XXe siècle.
Son ouvrage Age of Anger: A History of the Present (2017) examine les origines de la vague actuelle de haine et de violence et analyse l’impact des Lumières occidentales sur le monde moderne.
Pour ses contributions à la littérature, il a été élu membre de la Royal Society of Literature en 2008 et a remporté le Windham-Campbell Literature Prize en 2014 dans la catégorie non-fiction.
En plus de ses travaux littéraires, Mishra est un chroniqueur très sollicité et a écrit des essais pour des publications renommées telles que The New York Times, The New Yorker, The Guardian et The New York Review of Books.
Ses écrits se distinguent par une approche interdisciplinaire qui combine l’histoire, la philosophie et la politique pour éclairer les dynamiques complexes du monde moderne.
Actuellement, Pankaj Mishra vit à la fois à Londres et en Inde et travaille sur de nouveaux projets littéraires.



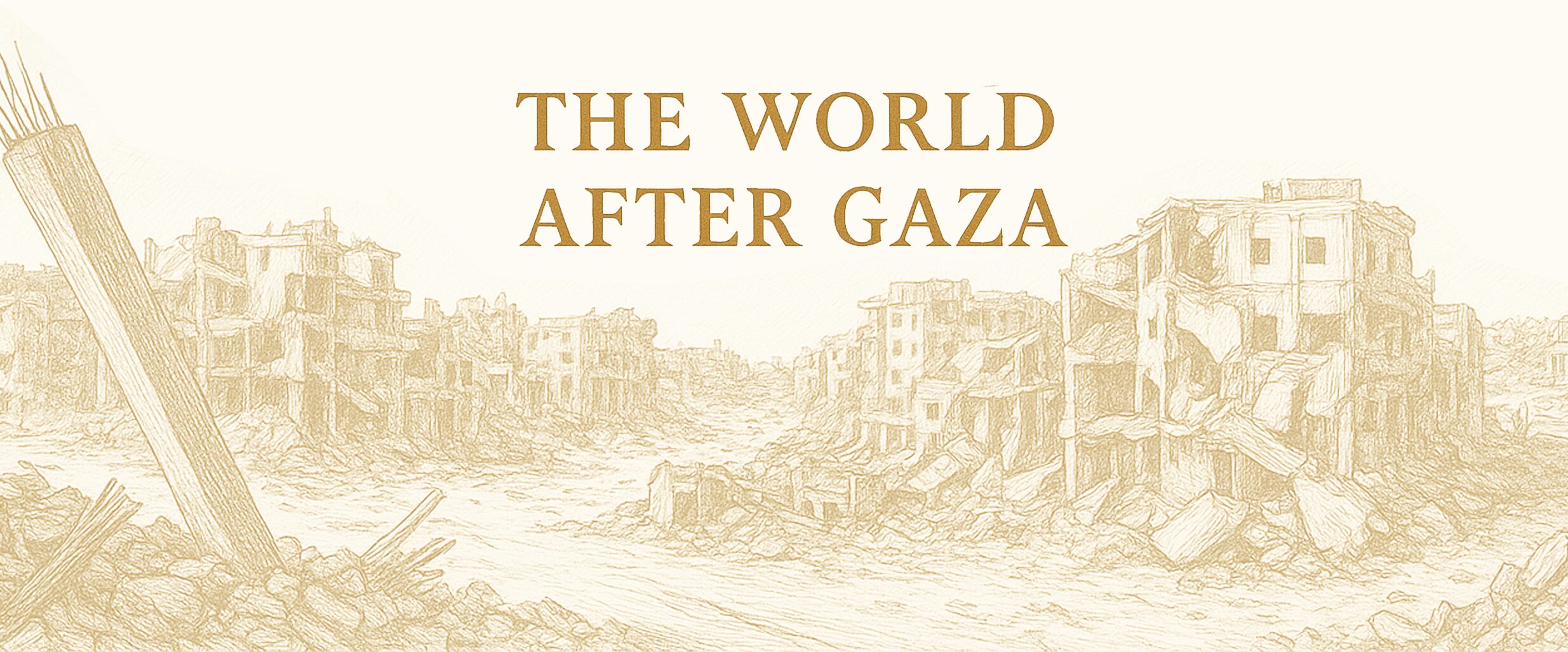


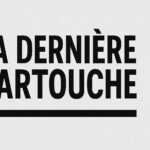 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















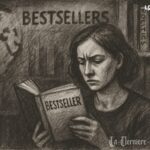 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.