![]()
Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
La voix qu’on abandonne
Pourquoi les radios allemandes ont peur de la langue
La France protège sa langue. L’Allemagne protège son excuse.
Depuis 1994, la loi Toubon oblige les radios françaises à diffuser au moins 40 % de musique francophone – une loi régulièrement tournée en dérision par les milieux radiophoniques allemands. Les arguments sont bien connus : paternalisme, déconnexion du marché, prétendu rejet du public. Mais la véritable question est ailleurs : que cherche-t-on vraiment à défendre ici ? La liberté de la langue – ou la liberté vis-à-vis de toute responsabilité ?
Tandis que la France intègre ses talents musicaux à travers la langue, le marché allemand dissocie radicalement les deux. La langue y est perçue comme encombrante, risquée, peu « cool ». La pop en allemand devient un genre marginal : hyperprivée, soigneusement formatée ou tellement ironique qu’elle n’émeut plus. Un paysage sonore qui se suffit à lui-même – aseptisé, redondant, calibré pour une consommation maximale. On entend peu, parce que peu est dit. On ressent peu, parce que rien n’est osé.
En France, la « quota musique » est un acte culturel, un outil d’estime de soi. En Allemagne, elle ferait figure de corps étranger dans un système qui s’est déjà accordé sur une moyenne algorithmique. La différence n’est pas technique, elle est culturelle. À Sarreguemines, Radio Mélodie diffuse du français, parce que son public le souhaite. À ICI Lorraine, le directeur de la programmation déclare : « Nous mettons la richesse culturelle au centre. » En Allemagne, en revanche, la devise de nombreuses stations privées est : « Nous voulons rendre les gens heureux. » Une formule en apparence anodine, mais qui révèle une dévitalisation d’un média entier – car la promesse du bonheur ne remplace pas une position.
La loi française n’est pas une politique nostalgique. Elle constitue une ligne de défense culturelle face à la dévalorisation mondiale du langage. Elle affirme : la langue est une origine. La musique n’est pas qu’un son – c’est une voix dans un espace qui veut être plus qu’un simple écho. La radio peut être caisse de résonance ou tapis sonore – et ce choix n’est jamais neutre.
Ce que personne n’ose dire à voix haute en Allemagne : il ne faut peut-être pas une loi. Mais il faut du courage – celui d’admettre qu’une grande partie de la musique allemande actuelle ne convainc tout simplement pas. Le problème, ce n’est pas la langue. C’est ce qu’on en fait.
Une voix perdue ne revient pas parce qu’on la regrette – mais parce qu’on veut l’entendre à nouveau. Peut-être, un jour, quelqu’un dira en Allemagne : pas « plus d’allemand à la radio », mais du meilleur allemand. Pas « plus de feelgood », mais plus de substance. Pas « plus d’écho », mais une voix retrouvée.
En attendant, la France a ses quotas. Non pas comme modèle. Mais comme avertissement.

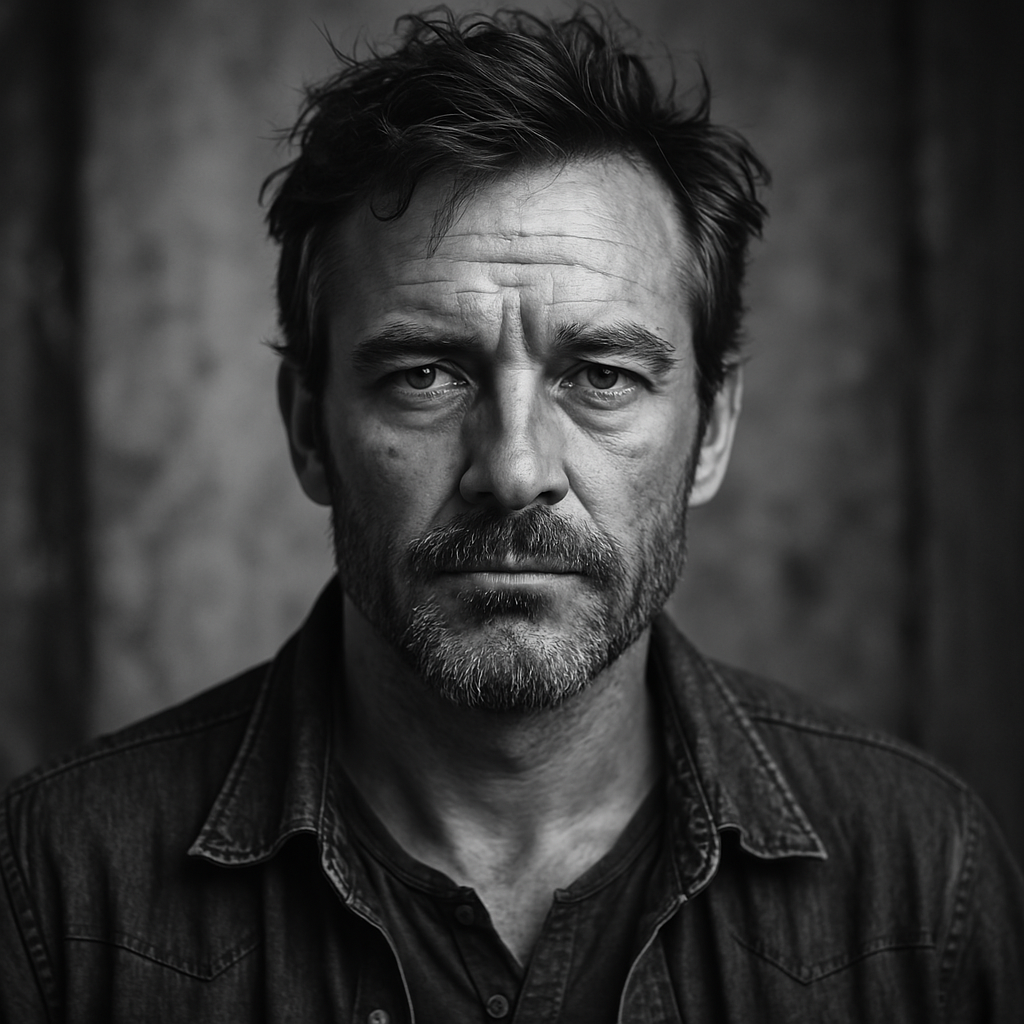




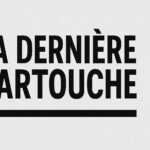 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.