![]()
Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
L’invention du roman en prose sur la Sarre.
Élisabeth de Lorraine‑Vaudémont (Élisabeth de Lorraine).

✍️ Solène M’Bali
Auteur, éditeur et architecte intellectuel de La Dernière Cartouche. J’écris à l’intersection de la politique, de l’histoire et de la critique des médias – de manière analytique, affirmée et indépendante. Mes sujets de prédilection : les enjeux européens, les perspectives oubliées et la réhabilitation du bon sens à l’heure des brouillards idéologiques. La Dernière Cartouche n’est pas un site d’actualités, mais un lieu de clarté, de profondeur et de résistance intellectuelle.
🗓️ Publié le : 26. juillet 2025
📰 Média : La Dernière Cartouche
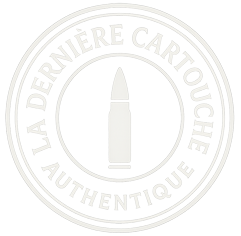

Raconté par Solène M’Bali – tissant une histoire à partir de fragments, manuscrits et pierres oubliées.

Aux rives de la Sarre, là où langues et récits se croisent, naquit une nouvelle façon de raconter. À Sarrebruck, à l’ombre des châteaux et sur les chemins des marchands, des mots allemands se façonnèrent pour des récits chevaleresques français – et de ce travail émergea une forme qui transforma la littérature.
Élisabeth de Lorraine‑Vaudémont naquit vers 1395 en Lorraine. Elle grandit dans un univers où l’on chantait des airs courtois, lisait des chroniques françaises, et nouait des alliances politiques par mariage. Le français et l’allemand coulaient en elle comme deux ruisseaux convergeant dans une vallée. Dès l’enfance, elle comprit que cette double langue n’était pas un fardeau, mais un atout : elle ouvrait des portes, elle reliait des mondes.
En 1412, elle épousa Philippe de Nassau‑Sarrebruck. Par cette union, son héritage lorrain se fondit avec une région étendue de la Blies et de la Sarre jusqu’au Rhin. Le paysage où elle résida désormais était marqué de châteaux perchés sur les collines, de marchés aux passages fluviaux et de luttes constantes pour le pouvoir. Élisabeth n’apporta pas seulement son nom : elle y apporta une éducation profondément ancrée dans la culture française, ainsi qu’une aptitude à relier cours et langues.
Les années auprès de son époux furent des années d’apprentissage. Elle évolua dans un réseau de titres, de revendications et d’alliances, observant l’équilibre entre proximité et distance exigé par chaque maison princière. Puis survint l’hiver 1429, et avec lui la mort de Philippe. À Sarrebruck, les chandelles s’éteignirent et l’avenir s’alourdit. Deux jeunes fils étaient incapables de régner, et un comté attendait une direction.
Élisabeth assuma la régence. Sarrebruck devint sous son autorité le centre administratif du comté. Elle restructura chancellerie et trésorerie, unifia des territoires dispersés en une entité gouvernable. Son style fut silencieux, mais ferme. Elle dirigea par écrit, par négociation, par la prudence d’éviter les conflits avant qu’ils ne se muent en violence.
Parallèlement à l’exercice du pouvoir, une autre sphère continuait d’exister en elle : les histoires. Depuis l’enfance, les romans chevaleresques français faisaient partie de son esprit. À Sarrebruck, elle les fit revivre. Sous son impulsion, quatre grandes œuvres furent traduites en allemand : *Herpin*, *Sibille*, *Loher und Maller* et *Huge Scheppel*.
Ce travail occupait les mêmes chancelleries où l’on rédigeait aussi les actes officiels. Élisabeth dictait, corrigeait, guidait. Des vers français naquit la prose allemande. Ce fut non seulement un examen linguistique, mais aussi un bond culturel.
Les érudits d’après désignent ces œuvres comme le début du roman en prose allemand. Avant ce moment, la prose existait, mais ici, sous le nom d’Élisabeth, une forme apparut, stable et durable. Son nom figure dans les préfaces des manuscrits – une reconnaissance rare pour une femme du XVe siècle. Elle ne fut pas seulement commanditaire. Elle fut l’intellect derrière l’œuvre.
Un nom dans une préface, un parchemin à Wolfenbüttel, une dalle funéraire à Saint-Arnual : de ces fragments croche un visage se révèle. Celui d’une femme qui régna et écrivit, qui gouverna et façonna le langage. Ces romans, nés sous sa direction, portaient héros, reines, intrigues et épreuves vers un nouveau public.
Élisabeth fit remodeler ces textes parce qu’elle savait que seuls survivent les récits racontés dans les paroles de ceux qui les écoutent. Sous sa main, les épopées chevaleresques quittèrent le cercle étroit des salons courtois pour intégrer une tradition narrative allemande.

Pendant que les parchemins s’accumulaient, la régence demeurait son activité quotidienne. Elle négocia avec Trèves, avec la Lorraine, avec des voisins aux voix pressantes. Elle gouverna avec persévérance. Sarrebruck resta sous sa surveillance une île d’ordre.
Son action relia deux espaces. Son origine était lorraine, son action sarroise. Elle apporta la culture française, mais l’ancrage se fit sur la Sarre. De cette dualité naquit une littérature qui dépasse les frontières.
Les traces de son œuvre traversent les siècles. Trois volumes du fils Jean se trouvent à Wolfenbüttel et à Hambourg. *Huge Scheppel* fut imprimé en 1500 à Strasbourg, portant encore son nom dans la dédicace. Pendant des siècles, ses traductions conservèrent leur importance, longtemps après que les voix des cours se soient tues.
Élisabeth mourut en 1456. Elle choisit Saint-Arnual à Sarrebruck comme lieu de sa dernière demeure. Elle y repose, et une pierre y porte son nom.
À la Sarre naquit la prose chevaleresque parce qu’Élisabeth de Lorraine‑Vaudémont mit les mots en mouvement. Son origine et son action reliant la Lorraine au Saarland donnèrent naissance à une page de culture européenne toujours vivante aujourd’hui.
Sources
– Les titres et références ont été traduits en français, mais les titres originaux allemands ont été conservés lorsqu’il n’existe pas de traduction (par exemple pour le catalogue d’exposition). Données biographiques primaires et contextes historiques
– Élisabeth de Lorraine, comtesse de Nassau-Sarrebruck. Wikipedia (allemand, anglais, français), consultation juillet 2025.
– Archives d’État de Hesse, Marburg – fonds relatifs au comté de Nassau-Sarrebruck.
Régence et rôle politique
– Schwinges, Rainer C. : Femmes dans la ville européenne au Moyen Âge. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1995, p. 201–203.
– Brück, Anton : Histoire du comté de Sarrebruck. Sarrebruck 1983.
Traductions et importance littéraire
– Brinker‑von der Heyde, Claudia : Traduire à la fin du Moyen Âge – Littérature courtoise française et sa transposition en allemand. Reichert Verlag, Wiesbaden 2010.
– Article « Élisabeth de Nassau‑Sarrebruck » dans le Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters, 2ᵉ éd., vol. 2, col. 273–280.
Roman en prose et question de genre
– Eis, Gerhard : Le roman en prose allemand du Moyen Âge. Hirzel, Stuttgart 1963.
– Bluhm, Lothar : « Élisabeth de Nassau‑Sarrebruck et les traductions en prose des épopées françaises. » In : Zeitschrift für deutsche Philologie 124 (2005).
Manuscrits & postérité
– Catalogues des manuscrits de la Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Cod. Guelf. 18.2 Aug. 2° et autres).
– Bibliothèque d’État et universitaire de Hambourg, collection de manuscrits : volumes provenant de la succession de Jean III de Nassau‑Sarrebruck.
– Behr, Hans‑Joachim : Les manuscrits d’Élisabeth de Nassau‑Sarrebruck. Hambourg 1987.
Réception & expositions
– Ir herren machent fryden – Élisabeth de Nassau‑Sarrebruck et son monde. Catalogue d’exposition, Historisches Museum Saar, Sarrebruck 2007.
– Jacobs, Ulrike & Jacobs, Manfred : La Passe‑frontière. Élisabeth de Lorraine. Biographie romancée, Sarrebruck 2007.




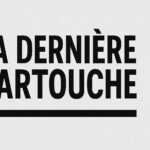 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















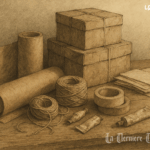 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS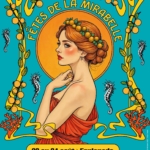 Metz et Metz Metropole 2025 Image freepix
Metz et Metz Metropole 2025 Image freepix
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.