![]()
Cet article est disponible en : 🇩🇪 Allemand
Pont-à-Mousson, la mémoire et l‘esthétique du silence (ou l’esthétique de l’omission)
Pont-à-Mousson, la mémoire et l’esthétique du travestissement.
Un essai de Jack O’Reilly
Lorsqu’on éteint l’écran, il reste un instant une image rémanente : une femme en habit de nonne, du sang sur les mains, les Vosges dans la brume à l’arrière-plan. C’est une belle image, presque trop belle. Les Combattantes raconte septembre 1914, le chaos des premiers mois de la guerre, quatre femmes qui, au milieu de l’effondrement, préservent leur dignité. Mais ce que la série montre, ce n’est pas la guerre : c’est son reflet – filtré par la lumière, le costume et le décor. Le Grand Est, qui en constitue ici le cadre, n’est plus un lieu, mais une scène.
Je connais ce paysage. Entre Pont-à-Mousson et Saint-Mihiel, la Moselle dessine de longues boucles dans un relief étroit. Le Bois-le-Prêtre, modeste forêt au-dessus de Montauville, est aujourd’hui un endroit silencieux, presque oublié. Entre 1914 et 1915, plus de vingt mille hommes y sont morts – Français et Allemands – souvent à quelques mètres les uns des autres. Leurs tranchées, leurs abris, leurs cris sont depuis longtemps recouverts d’herbe. La série cite ce lieu, mais ne le montre pas. Elle parle du front, mais évite ce qui est boueux, désordonné, indicible.
I. Saint-Paulin – le lieu inventé
L’histoire se déroule dans un village fictif nommé Saint-Paulin. Il se situe quelque part dans les Vosges, non loin de la ligne de front. Une jeune infirmière parisienne, Suzanne, fuit la justice pour avoir pratiqué des avortements. Par hasard, elle trouve refuge dans un couvent transformé en hôpital militaire. Là, elle rencontre la supérieure, Mère Agnès, l’épouse d’industriel Caroline, contrainte de reprendre l’usine d’armement de son mari, et Marguerite, une prostituée venue au front pour d’autres raisons. Quatre femmes, quatre chemins, quatre formes de résistance.
C’est la force de la série : elle raconte la guerre de l’intérieur, depuis l’espace féminin. Mais le lieu où elle le fait est une construction. Le tournage a eu lieu à Bains-les-Bains, à l’abbaye de Valloires en Picardie et à la Chartreuse de Neuville, donc loin du véritable front. On y a recouvert les rues de terre, retiré les panneaux modernes, muré les fenêtres – on a recréé la scène, mais remplacé le lieu.
Ce n’est pas un hasard si Les Combattantes revendique le Grand Est sans le montrer. Le poids de l’histoire y serait trop lourd, le paysage trop contradictoire. Entre Metz, Nancy et Verdun se concentre la mémoire de l’Europe : dense, encombrée, inconfortable. On n’y tourne pas une belle guerre.
II. Paysages tournés
La production fut immense : plus de cent cinquante rôles parlants, trois mille figurants, des chevaux, des camions, des canons, des uniformes. Le réalisateur Alexandre Laurent a composé de la région un tableau qui rappelle la peinture du XIXᵉ siècle – brouillard de lumière, lignes claires, une composition qui tient plus de Gérôme ou de Detaille que de la guerre de 1914. La forêt n’est jamais grise, le sang jamais noir, le ciel jamais déchiré.
Il ne faut pas forcément y voir une faute morale. Peut-être que la télévision a besoin de cette esthétique pour pouvoir encore raconter. Mais elle a ses effets : là où la boue régnait, il y a maintenant du lin ; là où grondait le bruit, on entend de la musique. La ligne de front devient une expérience morale, non plus un lieu de mort.
Pourtant, le Grand Est n’était pas une abstraction. La guerre y fut totale. Pont-à-Mousson fut détruite à quatre-vingts pour cent, l’abbaye des Prémontrés brûla, Saint-Mihiel resta occupée pendant quatre ans, le Bois-le-Prêtre devint un charnier permanent. Dans Les Combattantes, il ne reste presque rien de tout cela : pas de ruines, pas de mutilés, pas de morts sans visage. La guerre y demeure propre.
III. Les religieuses – gardiennes du seuil
Le couvent est le centre de la série. Mère Agnès, interprétée par Sandrine Bonnaire, se tient entre obéissance et humanité. Les nonnes lavent les plaies, prient, doutent. On pourrait croire qu’une autre perspective s’ouvre : des femmes qui ne font pas la guerre, mais la soignent. Pourtant, ce lieu lui aussi est stylisé.
Les modèles historiques étaient tout autres. À Pont-à-Mousson, Nancy et Verdun, des centaines de religieuses travaillaient dans des hôpitaux improvisés – souvent sous le feu français et allemand, sans abri, sans repos. Les archives mentionnent les Sœurs de Saint-Charles de Nancy, les Filles de la Charité, les Sœurs de la Miséricorde de Metz. Elles soignaient des hommes au visage déchiqueté, des amputés, des victimes de gaz. On ne lit dans leurs rapports rien de romantique : seulement la discipline, l’épuisement et la foi.
Dans Les Combattantes, cette souffrance devient abstraction. Le couvent devient symbole : un lieu où l’ancien ordre se brise. La caméra glisse lentement, la lumière tombe comme à travers un vitrail. La douleur devient belle, presque contemplative.
IV. Le silence sur la Lorraine
Ce qui frappe, ce n’est pas ce qui est montré, mais ce qui manque. La série se passe en Lorraine, mais ne parle jamais de la Lorraine. Pas un mot sur la division séculaire de cette région entre France et Allemagne, pas un accent, pas un panneau bilingue, aucun signe de son ambivalence politique et culturelle.
C’était pourtant le cœur du conflit : des hommes et des femmes à la fois français et allemands, catholiques et républicains, ouvriers et paysans, croyants et sceptiques. La guerre de Lorraine fut une guerre civile à l’échelle européenne. Mais Les Combattantes franchit cet abîme sans s’y arrêter. L’ennemi reste sans visage, l’autre demeure abstrait.
On peut y voir un choix narratif : le regard se concentre sur les femmes, non sur les lignes de front. Mais ce silence a ses conséquences : il efface l’identité régionale. Le Grand Est se réduit à une texture – brouillard, forêts, villages. L’histoire réelle, celle qui s’y est jouée, reste tue.
V. La belle guerre
Les Combattantes est un chef-d’œuvre de reconstitution. Uniformes, harnais, lampes, cartouchières – tout est impeccable. Même la saleté semble composée. La musique porte les scènes comme une messe. C’est comme si l’indicible avait trouvé sa forme.
C’est à la fois fascinant et dangereux. La France a une longue tradition de beauté guerrière : de David à Delacroix, jusqu’à Malraux. Le regard héroïque ne disparaît jamais, même dans la souffrance. Les Combattantes prolonge cette lignée – seulement, l’héroïsme y est devenu féminin.
Mais la beauté a un prix. Quand la douleur prend forme, elle perd de sa force. Les blessés meurent dignement, non défigurés. Les religieuses restent pures, non souillées. La guerre ne sent pas. Tout demeure supportable.
On peut y voir un apaisement – ou une manière d’oublier. La série ne montre pas l’horreur ; elle montre le besoin de la dompter.
VI. Résonance
L’été dernier, je suis retourné à Pont-à-Mousson. Dans le vieux cimetière militaire, l’herbe monte jusqu’aux croix. Du Bois-le-Prêtre vient le vent. Au loin, une cloche sonne.
Là où la série situe son village inventé de Saint-Paulin, il n’y a en réalité que du silence. Et pourtant, ce silence parle plus que toutes les images. Le Grand Est n’est pas un décor, mais un corps de mémoire. Il faut l’écouter pour le comprendre.
Les Combattantes raconte une guerre qui se lit sur les visages. Mais elle la raconte comme si elle était finie.
Or, dans ce paysage, elle ne l’est jamais tout à fait.
C’est peut-être là sa véritable tragédie : la mémoire ne redevient visible qu’une fois rendue filmable.
Pont-à-Mousson, Saint-Mihiel, Bois-le-Prêtre – tous ont survécu parce que plus personne ne les regarde.
Et c’est peut-être le point aveugle que la série révèle malgré elle : l’histoire ne revient que lorsqu’elle se déguise en décor.
DIMENSION TOPOGRAPHIQUE
Carte des lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale
Région de Pont-à-Mousson (Grand Est)
Note
Cette carte interactive rassemble les principaux lieux de mémoire du saillant de Saint-Mihiel, entre Verdun et Pont-à-Mousson. Elle met en perspective le territoire réel évoqué dans la série Les Combattantes et permet d’en suivre les traces topographiques et historiques.
| Lieu / Site | Type / Caractère | Distance de Pont-à-Mousson | Contexte historique | Référence à Les Combattantes |
|---|---|---|---|---|
| Nécropole nationale du Pétant (Pont-à-Mousson) | Cimetière militaire (≈ 1 400 tombes) | — (dans la ville) | Soldats tombés entre 1914 et 1918 ; premières lignes sur la Moselle | Correspond au contexte fictif de la « proximité du front » ; témoigne des pertes réelles de la région |
| Abbaye des Prémontrés (Pont-à-Mousson) | Ancienne abbaye, hôpital militaire 1914–18 | — | Lieu historique du soin spirituel et hospitalier pendant la guerre | Équivalent réel du couvent « Saint-Paulin » dans la série |
| Monument du Bois-le-Prêtre (Montauville) | Monument commémoratif | env. 5 km SO | Lieu de combats intenses en 1914–15 ; plus de 20 000 morts | Référence topographique directe à la « forêt du front » de la série |
| Ossuaire du Bois-le-Prêtre | Ossuaire / lieu de mémoire | env. 5 km SO | Dédié aux soldats inconnus ; symbole du sacrifice collectif | Illustre ce que la série choisit d’omettre sur le plan visuel |
| Fort de Liouville (Apremont-la-Forêt) | Ouvrage militaire / Fort Séré de Rivières | env. 8 km S | Élément du rideau défensif des Hauts de Meuse, fortement bombardé dès 1914 | Reflète l’environnement militaire évoqué seulement en arrière-plan |
| Musée 14–18 de Marbotte (Apremont-la-Forêt) | Musée / exposition | env. 8 km S | Photographies, uniformes et objets du quotidien de la Grande Guerre | Complète la perspective militaire par des témoignages civils de la région du front |
| Saint-Mihiel – Nécropole nationale | Cimetière national (≈ 10 000 tombes) | env. 25 km S | Centre de l’occupation allemande entre 1914 et 1918 | Écho géographique au front représenté dans la série |
| Exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel (Saint-Mihiel) | Exposition historique / centre documentaire | env. 25 km S | Documents et objets relatifs aux combats du saillant de Saint-Mihiel (1914–18) | Apporte la profondeur historique absente de la narration télévisée |
| Musée de la Baïonnette (Regniéville) | Musée / collection 14–18 | env. 30 km SO | Établi sur d’anciennes tranchées ; consacré aux combats de Regniéville | Donne un visage concret à la guerre que la série abstrait |
| Tranchée de la Soif (Ailly-sur-Meuse, Bois d’Ailly) | Tranchée restaurée / parcours pédagogique | env. 20 km S | Ancienne position française dans le Bois d’Ailly au sud du saillant de Saint-Mihiel | Montre ce que Les Combattantes évite : la boue, le bruit, la mort |
| Église Saint-Laurent (Montauville) | Église paroissiale / plaques commémoratives | env. 5 km SO | Plaques du 166e régiment d’infanterie | Lieu vivant de mémoire locale |
| Route de la Mémoire 14–18 (Verdun–Saint-Mihiel–Pont-à-Mousson) | Itinéraire thématique / circuit culturel | — (Région Grand Est) | Réseau reliant les principaux sites commémoratifs du front de la Meuse | Invite à une approche documentaire au-delà de la fiction |
Corrections effectuées suite à la remarque d’une lectrice (octobre 2025).
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Laisser un commentaire
Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen

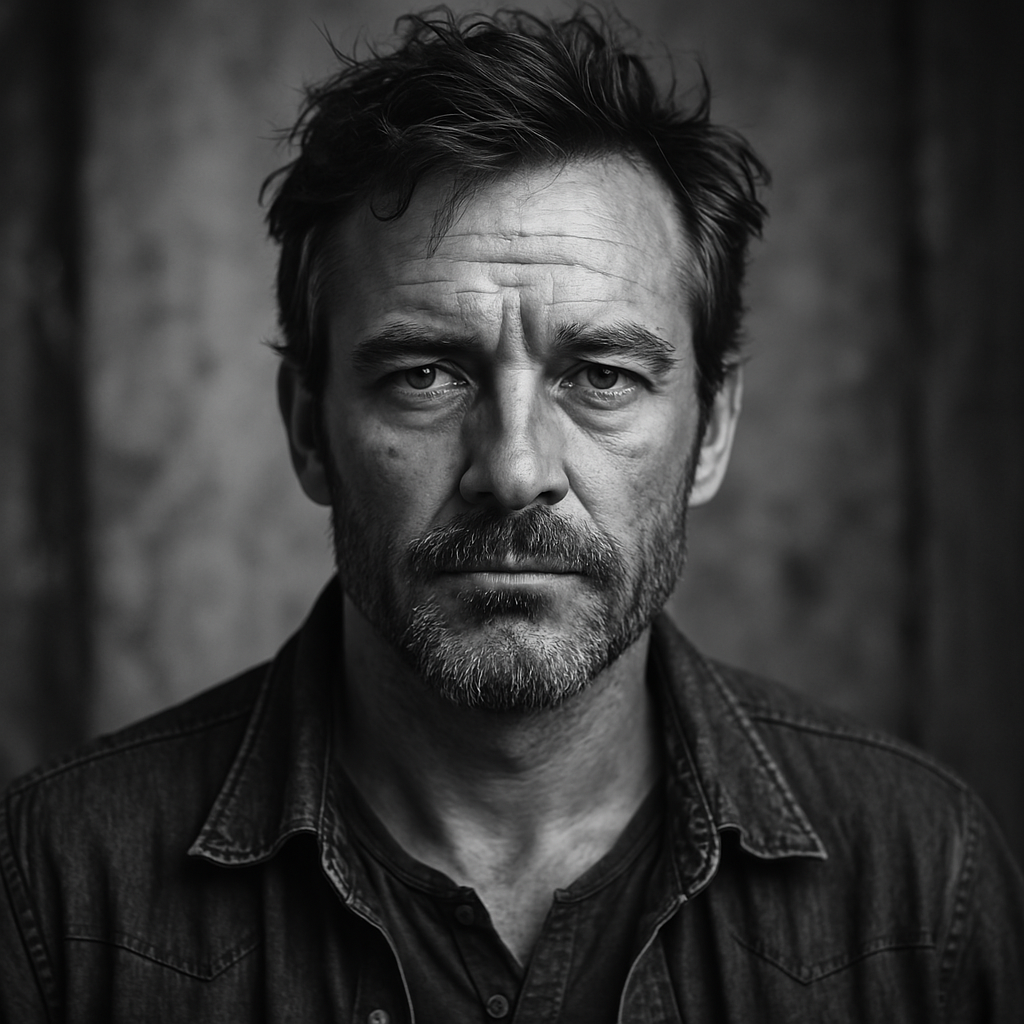


 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche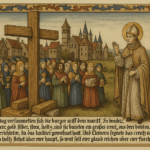
 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS La Dernière Cartouche © 2025 La Dernière Cartouche / Illustration: Arion
La Dernière Cartouche © 2025 La Dernière Cartouche / Illustration: Arion





















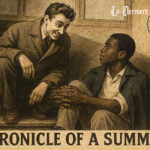 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Bonjour.
Il y a quelques petites erreurs dans votre tableau… Il n’y a pas de musée à Hattonchâtel sur le Saillant de Saint-Mihiel. Il existe une exposition à Saint-Mihiel, ou bien le musée de la baïonnette à Regniéville.
La Tranchée de la Soif se trouve à Ailly-sur-Meuse et non pas à Regniéville.
Le Fort de Liouville ne fait pas partie de la ceinture de Toul
Merci beaucoup pour votre remarque, nous allons corriger cela immédiatement.