![]()
Note rédactionnelle
Jean Rouch – ethnologue, cinéaste, passeur entre science et poésie.
Il a observé l’Afrique à travers la caméra, mais plus il filmait, plus la ligne de séparation entre l’observé et l’observateur s’effaçait. Sa méthode, le « cinéma vérité », n’était pas une tentative de fixer une vérité objective, mais bien celle de la saisir dans le mouvement même de son apparition.
Clémence Moreau pose la question essentielle : que se passe-t-il lorsque la caméra devient un acteur moral ? Et peut-on filmer un être humain sans le posséder ?
Elle ne cherche pas à expliquer, mais à remettre de l’ordre dans un monde qui explique trop. Car pour elle, écrire n’est pas exprimer une opinion, mais une attitude. Et toute attitude naît de la retenue.
Jean Rouch et la vérité mouvante
(Un essai de Clémence Moreau)
Sur les rives du Niger, en 1946, Jean Rouch perd son trépied. L’eau engloutit le métal, comme si elle voulait emporter le dernier reste de stabilité du monde de l’observation. Rouch tient la caméra, mais sans appui, sans soutien. Dès lors, il doit la manier comme un organe qui réagit, non qui domine. C’est une naissance du cinéma documentaire moderne¹, et en même temps l’adieu à l’idée qu’on puisse retenir la vérité en la figeant.
Rouch n’était pas un cinéaste au sens habituel du terme, mais un ingénieur et un ethnologue². Un homme parti en expédition avant de trouver un style. Élève de Marcel Mauss³, il avait appris que chaque geste est un acte social, un petit contrat entre le moi et l’autre. Rouch a transposé cette idée à l’image. La caméra n’était pas pour lui un œil scientifique, mais une partie de ce contrat. Elle ne devait ni cacher ni révéler, mais participer.
Lorsqu’il commença à filmer en Afrique de l’Ouest, le film ethnographique était un instrument de preuve⁴. On filmait pour classer, pour nommer, pour montrer ce que faisaient « les autres ». La caméra restait immobile, parce qu’on croyait que la connaissance exigeait la distance. Rouch pressentait au contraire que la distance pouvait être une forme de mensonge. Il s’approcha, et à chaque pas il perdit un peu d’autorité.
Dans ses premiers films, comme Les Maîtres Fous (1954), cette proximité devint une expérience⁵. Rouch filme un rituel des Hauka au Ghana, où les participants tombent en transe et incarnent les figures du pouvoir colonial : le gouverneur, l’officier, l’ingénieur. Ils parodient le pouvoir jusqu’à ce que la parodie elle-même devienne extase. L’Occident, qui croyait observer, se découvre soudain dans le miroir – caricature, démon, reflet.
Ce film fit scandale⁶. Il fut en Europe tour à tour interdit, admiré ou jugé indécent. La gauche reprocha à Rouch de romantiser les opprimés ; la droite, d’insulter la civilisation. Il resta entre les deux, seul. Mais son intention n’était ni la provocation ni la défense. Il voulait comprendre comment les hommes, sous le poids de l’histoire, inventent des rituels pour la supporter. La transe n’était pas pour lui un spectacle, mais un langage⁷.
Ousmane Sembène, le grand cinéaste sénégalais, lui lança plus tard : « Tu nous regardes comme des insectes. »⁸ Cette phrase est cruelle, mais juste, car elle nomme le problème moral de toute ethnographie : le regard qui croit pouvoir s’exclure de ce qu’il voit. Rouch ne répondit pas par des mots, mais par son travail. Il continua à filmer, autrement – en mouvement, en dialogue, dans le risque.
Son film Jaguar, commencé en 1957 et achevé dix ans plus tard, montre trois jeunes hommes voyageant du Niger au Ghana pour chercher du travail⁹. Le film est à la fois observation et fiction. Rouch tourne les images, mais ce n’est que plus tard, en salle de montage, que les hommes commentent ce qu’ils voient. Ils rient, se contredisent. Le film devient un lieu d’auteur partagé. Rien n’y est figé.
Rouch appela cette méthode cine-trance¹⁰. Il n’entendait pas par là l’ivresse, mais le passage. La caméra, disait-il, doit elle-même entrer dans un état où elle ne se contente plus d’enregistrer, mais résonne. Le cinéaste devient partie du rituel sans le posséder. Cette attitude est à la fois radicale et dangereuse : elle exige la proximité là où la science demande la distance, et la morale là où l’art réclame la liberté.
Dans Chronique d’un été (1961), tourné avec Edgar Morin, ce principe trouve sa forme française¹¹. Le film commence par une question simple posée à des passants à Paris : « Êtes-vous heureux ? » Une question banale, mais qui ouvre tout. La caméra accompagne des gens qui se montrent dans la rue, chez eux, dans la parole. Pas de commentaire, pas de musique, pas de dramaturgie. Seulement le temps, le souffle, l’hésitation.
Rouch et Morin voulaient savoir si l’on peut filmer la vérité¹². À la fin, ils durent admettre que non – et que c’est précisément là que réside le sens. La vérité s’échappe dès qu’on la cherche. Elle ne vit que dans le mouvement, dans l’espace entre la parole et le silence, dans l’instant du regard. Chronique d’un été s’achève sur le désenchantement de sa propre méthode : les filmés voient leurs scènes et ne se reconnaissent pas. Le cinéma ne montre pas les choses telles qu’elles sont, mais telles qu’elles deviennent quand on les regarde.
Cette découverte n’est pas esthétique, mais morale¹³. Elle touche à la position du filmeur face à ce qu’il montre. Jean Rouch savait qu’on ne peut posséder la vérité sans la détruire. Cela le distingue de ceux qui revendiquent aujourd’hui l’authenticité comme un effet de style. Le cinéma de Rouch n’a pas de message, seulement une attitude : patience, respect, attention.
Dans les films qu’il réalisa avec Germaine Dieterlen sur les Dogon du Mali, cette attitude devient visible comme une prière¹⁴. Pendant des décennies, de 1950 à 1974, ils observèrent des rituels, des cérémonies, le cycle du Sigi. Pas de musique, pas de commentaire. Seulement des images lentes, presque humbles, adaptées à la durée du réel. On peut les trouver ennuyeuses si l’on est habitué à la télévision. Ou les voir pour ce qu’elles sont : une éthique du regard.
Pour Rouch, la caméra n’était pas un œil, mais une voix¹⁵. Elle parle en se taisant. Elle ne juge pas ce qu’elle voit, elle l’accompagne. Cela le distingue du « observational cinema » britannique et de la franchise américaine des années soixante-dix. Son regard est français, c’est-à-dire non pas neutre, mais civilisé.
Notes
1. Paul Henley, The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema, Chicago / Londres 2010, p. 21–23.
2. Eva Hohenberger, La réalité du film : film documentaire, film ethnographique, Jean Rouch, Hildesheim 1988, p. 45.
3. Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Francfort s. M. 1978 (éd. orig. 1950), p. 22 sq.
4. Henley 2010, p. 55 s.
5. Jean Rouch, Les Maîtres Fous [film], France 1954.
6. Julian Vigo, « Power/Knowledge and Discourse : Turning the Ethnographic Gaze Around in Jean Rouch’s Chronique d’un Été », in : Visual Sociology, 1995, p. 16.
7. Hohenberger 1988, p. 72 sq.
8. Ousmane Sembène, cité par Jeff Himpele / Faye Ginsburg, « Ciné-Trance : A Tribute to Jean Rouch (1917–2004) », in : American Anthropologist 107 (2005), p. 108.
9. Henley 2010, p. 134 s.
10. Paul Stoller, The Cinematic Griot : The Ethnography of Jean Rouch, Chicago / Londres 1992, p. 11 sq.
11. Rouch / Morin, Chronique d’un été [film], France 1961.
12. Henley 2010, p. 203.
13. Hohenberger 1988, p. 119.
14. Série WDR : Rituels des Dogon, Allemagne 1998 (réédition 2000).
15. Stoller 1992, p. 98 s.
16. Hohenberger 1988, p. 152.
17. Henley 2010, p. 312.
18. Archives de la Berlinale, Jean Rouch – Le rêve plus fort que la mort, programme du festival 2002.
19. Paul Stoller, « Jean Rouch’s Legacy », in : Anthropology Today, vol. 21 (2005), p. 23.
Bibliographie (alphabétique)
Archives de la Berlinale : Jean Rouch – Le rêve plus fort que la mort. Programme du festival 2002.
Henley, Paul : The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema. University of Chicago Press, Chicago / Londres 2010.
Himpele, Jeff / Ginsburg, Faye : « Ciné-Trance: A Tribute to Jean Rouch (1917–2004) ». In : American Anthropologist 107 (2005), p. 108–128.
Hohenberger, Eva : La réalité du film : film documentaire, film ethnographique, Jean Rouch. Olms, Hildesheim 1988.
Mauss, Marcel : Sociologie et anthropologie. Suhrkamp, Francfort s. M. 1978 (éd. orig. 1950).
Rouch, Jean / Morin, Edgar : Chronique d’un été [film]. France 1961.
Rouch, Jean : Les Maîtres Fous [film]. France 1954.
Stoller, Paul : The Cinematic Griot. The Ethnography of Jean Rouch. University of Chicago Press, Chicago / Londres 1992.
Stoller, Paul : « Jean Rouch’s Legacy ». In : Anthropology Today, vol. 21 (2005), p. 22–25.
Vigo, Julian : « Power/Knowledge and Discourse: Turning the Ethnographic Gaze Around in Jean Rouch’s Chronique d’un Été ». In : Visual Sociology 1995, p. 14–38.
WDR : Rituels des Dogon. Série documentaire, Allemagne 1998 / 2000.
Jean Rouch (Réalisation | Caméra | Scénario)
« Je ne crois pas qu’il existe une frontière entre la science et l’art. Tous les films de fiction que j’ai réalisés ont toujours porté sur le même sujet : la découverte de l’Autre, une exploration de la différence. »
De la collaboration entre un anthropologue et un sociologue naît une étude réflexive et pénétrante sur le comportement humain. Ce documentaire est un classique influent du cinéma vérité – dont le nom fut d’ailleurs inventé par son co-réalisateur Edgar Morin !
La bande-annonce provient de mubi.com.



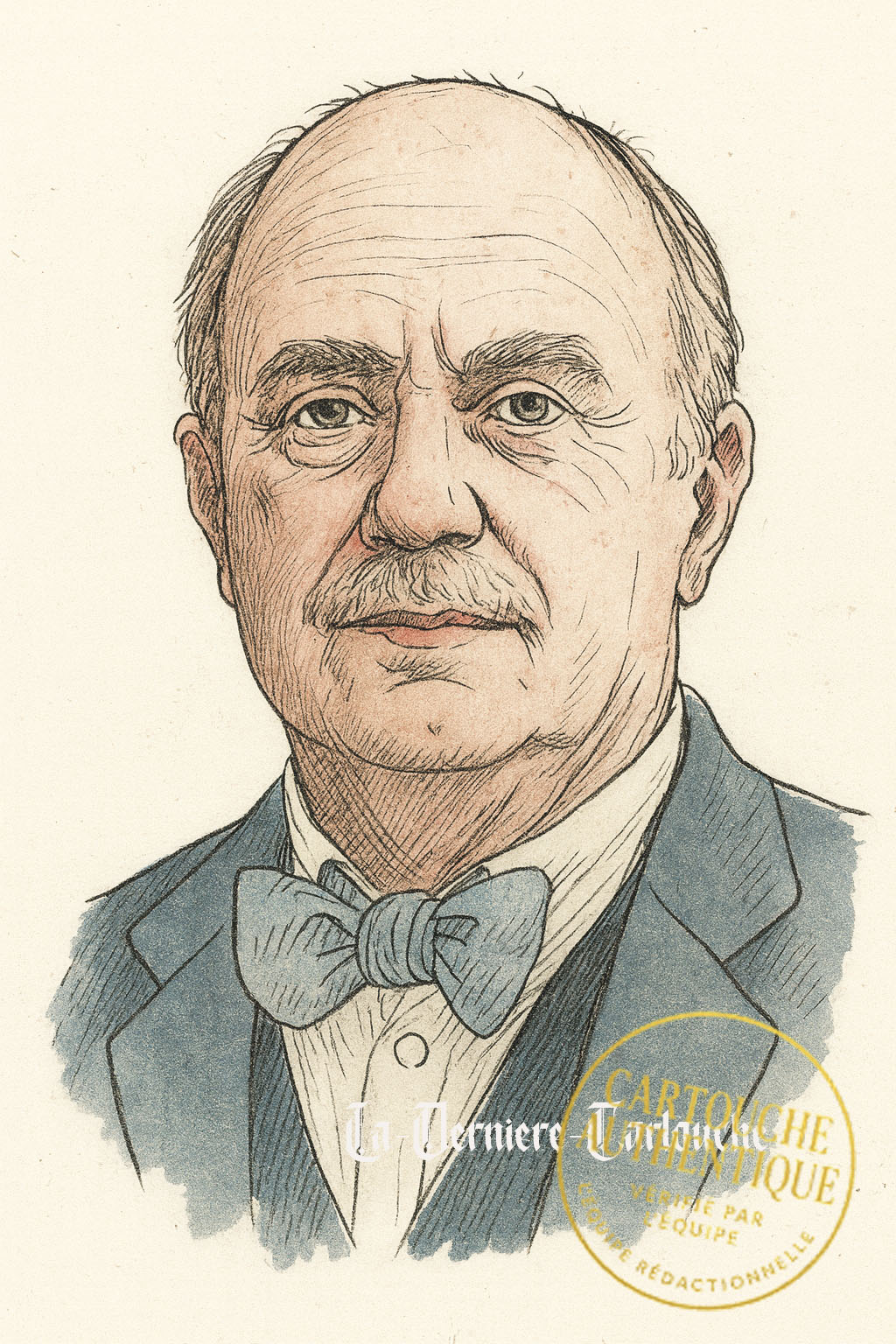

 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Markus Lüpertz Porträtkarikatur
 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.